« L’obscure intimité du creux de la chaussure »* – Première partie–
Ses jambes dans ses bottines ne vous semblent-elles pas des plumes dans un encrier ?**
Si Pétrus Borel n’était de son époque, il serait du siècle d’avant, au moins pour la raison qu’il fut celui de la chaussure et même celui du pied ; non point le pied rimé, mais l’arrimé à la bottine, l’escarpin, le soulier enfin. Le rétifisme est du XVIIIème, le siècle de sa date de naissance comme dénomination, qui vit peindre et écrire tant de pieds chaussés et déchaussés aussi : vénération, sacralisation, adoration, érotisation, attirance quasi obsessionnelle, attrait collectif, fantasmes d’une époque tout aux fêtes galantes, des courbures des nuages jusqu’aux courbes des corps, seraient-ils retenus volontaires derrière la porte d’une chambre fermée par son Verrou.1 Habillés ou nus, mais habillés, les pieds féminins devenus objets esthétisés de la convoitise et du désir à vif, sont enveloppés de soie, enrubannés, rose moiré et richement brodés2. Les romans n’ont rien à envier aux tableaux des peintres. Le jour de ses noces, le pied de Victoire, son joli pied était chaussé d'un soulier de perles, qu'attachait une boucle brillante, oblongue en lacs d'amour, du dernier goût2. Dans Le Pied de Fanchette Lussanville, avant d’être un époux comblé fut un adorateur extatique et confit de dévotion du pied de sa belle, qu’il n’avait pourtant de cesse de recouvrir de cuirs fins et autres satins ornés et nacrés, comme d’une seconde peau. Restif de la Bretonne, auteur prolifique au nom souvent plus connu que son œuvre, donne pour sous-titre à son roman, Le Soulier couleur de rose3 ; toute synecdoque fait preuve sans démonstration, aussi du pied au soulier il n’y a pas l’épaisseur du plus ténu tissu, littérairement parlant. Ces souliers qui rendent les pieds qu’ils cachent si désirables sont des souliers ornés, des souliers parfaits, qui supportent –on ne le sait que trop comme lecteurs de Freud– la charge déplacée, trans/portée, portée ailleurs, la méta/phore du désir ; qui dérobent l’attirance sous l’attrait ; qui rendent supportable l’impatience, la faisant disparaître dans des boucles de dentelles que l’on appellera un peu plus tard une fois nouées aux chapeaux des dames, des suivez-moi-jeune-homme. Ils sont surtout, et Restif de la Bretonne eut de nombreux et célèbres prédécesseurs4, souliers de femmes et pour les femmes, des chaussures belles qui rendent belles celles qui les enchaussent, ou, comme la pantoufle de Cendrillon, réalisent un miracle. En un mot, des souliers raccommodeurs.
Jamais il n’y est question de souliers abîmés, usagés, déformés ; ils sont des souliers sans passé en somme, qui s’étant peu promenés, n’ont pour autant jamais voyagé ; tout juste certains ont-ils été balancés dans l’air par la pointe d’un pied tendu, ce que Fragonard nomme Les Hasards heureux de l’escarpolette5 . Presque inexistantes, sinon écrites ou peintes, les chaussures galantes sont le contre-pied des Vieux Souliers aux lacets6, qui contredisent à leur tour la vision claudélienne pour laquelle la chaussure sépare le pied de la terre, qui l’exhausse, qui l’empêche d’être souillé par la boue et meurtri par l’obstacle7. A tous ces chaussants il manque une histoire, d’aucuns diraient un récit, d’autres une mémoire voire une biographie ; même les godillots de Van Gogh ont perdu de leur écrasante dignité, devenant objets de réflexions puis de querelles philosophiques, de Heidegger à Derrida, interrompus par Meyer Schapiro8, qui remet les lacets et les semelles dans le sens de la marche, et les souliers sur leurs pieds. Qui de Derrida ou de Van Gogh est le meilleur cordonnier ? Pétrus Borel, assurément ! que personne ne cite ni n’invite à l’atelier, Borel9 l’auteur de trois monographies sur la chaussure, dans la revue L’Artiste10; auteur du génialissime Le gniaffe (1841) qui sait de quoi il parle, c’est le moins qu’on puisse dire. Tous les termes du métier de la cordonnerie sont convoqués, les outils : empeignes, tranchet, kriss, yatagan, tire-pied, embouchoir, berloque de boueux11 , lisse, vieilloire, alènes, clous, sébile, baquet de science11 , marteau, tenailles, caillobotin pour les soies et le fil ; les apprentis sont semainiers, gorrets –à la pâte et coupeurs– ; les cordouaniers, les bazaniers, les savatiers ou savetoniers, et les sueurs de vieil sont les anciens noms du savetier ; et les mots des chaussures : l’escarpin retourné, la botte sans coutures, le soulier de bal du poids de deux onces, fait d’épiderme de sylphide ou de satin étiolé, le maroquin à couche-point, les baraquettes qui ont plus de papier que de cuir, justes bonnes à être envoyées aux Amériques. Jusqu’à l’invention d’une étymologie fantaisiste –que ne renierait pas Jean-Pierre Brisset– : le cordonnier l’homme qui, oubliant son cordon chez le roi, a fait le cordon nié ; omission pour laquelle le monarque l’aurait condamné à devenir un confectionneur de chaussures. Un cordon-nier, dont on apprend un peu plus loin qu’il est homme toujours brave… au moins depuis Henri IV ! Ce gniaffe-là, le pur-sang, est aussi le roi du calembour, vessie-six-tude, et, toujours un roi au détour de la phrase, comme le dénommé Robert cette fois, le gniaffe décidément brissettien (un peu) avant l’heure, chante O cru navet espèce unica ! (O crux ave, spes unica) 12 ou évoque la Muse Terpsi-shore ! Tel est le gniaffe de haute tenue à ne surtout pas confondre avec le savetier, un misérable porte-balle. Sur l’étymologie Borel se rattrapera à la fin de son texte, convoquant le grec.
Tout aurait pu en rester là, Restif de la Bretonne et Pétrus Borel n’ayant tout compte et tout conte faits, qu’un seul point commun, la misère de leur condition d’écrivain. Car pour les souliers et les pieds, tout les sépare en les opposant pour toujours. Nicolas, prolixe graphomane libertin, ne cesse de parler des sandales que pour mieux parler de lui, Pétrus écrit et décrit avec humour et gouaille, les chaussures et les cordonniers desquels il sait tout, même si l’on se demande bien pourquoi. Un mystère à ce jour non résolu. Mort en 1859 sous le cagnard algérien, Pétrus Borel et ses textes furent conjointement oubliés du plus grand nombre ; pour le petit nombre, il fallut attendre, on le sait, la propension des Surréalistes à sortir de l’oubli les oubliés de l’écriture. Borel en fit partie, mais y retourna presque aussitôt. Sauf pour quelques fondus qui, plus tard, ramenèrent dans le giron de l’édition par leur entêtement savant, leur travail rigoureux, leur ténacité de folie et rendirent recevable, présentable, acceptable et sortable ce contemporain et proche d’Hugo, Gautier, Vigny… De Pétrus Borel on croyait tout avoir à défaut de tout savoir. Jusqu’en 1978, soit 119 ans après sa mort, où sortie d’on ne sait quelle inadvertance, une paire de souliers se présenta : vieux, usés, lézardés, craquelés, s’éventrant/Percés de toutes parts. Pensez-donc ! remisés pendant plus d’un siècle, et même 128 ans si l’on décompte depuis leur date d’apparition au monde sous la plume du Lycanthrope Borel, 1850. Aussi, chaussant l’un ses bésicles, l’autre ses lunettes, deux compères en borélie prirent la décision frénétique de faire sortir le loup du bois, les souliers de la boîte, le poème de l’ombre. D’autant que d’ombre, il n’y en avait quasi point : le voyageur qui raccommode ses souliers, long et étonnant poème de 273 vers rimés de 12 pieds, fut écrit à Constantine, dédié à l’ami Adrien Berbrugger, spécialiste incontesté de l’Algérie, partant pour les oasis extrêmes. Les souliers poétiques de Pétrus Borel firent l’objet d’un tirage à 500 exemplaires, alors qu’un ciel aphotique versait incontinent ses pluviôses au mitan de l’été13 1978, à la Chaux de Cossonay, Suisse.
(à suivre…)
* Heidegger in Chemins qui ne mènent nulle part. (1949) ; trad. Française (1962), p. 34 ; Editions Gallimard, collection Tel. **Pétrus Borel, in Champavert
1) Fragonard, 1777 ; 2) Rétif de la Bretonne, Le Joli Pied, in Les Contemporaines, (1780-1785) ; 3) 1769 ; 4) on reprendra l’étude de Gabriel-Robert Thibault in Etudes rétiviennes n° 7, déc. 1987 qui cite par exemple, Rabelais, Brantôme et Lesage ; 5) entre 1767 et 1769 ; 6) Van Gogh, 1886 ; 7) P. Claudel, Commentaires et exégèses. 8) Heidegger et « L’origine de l’œuvre d’art » (1935), Meyer Schapiro, « L’objet personnel, sujet de nature morte. À propos d’une notation de Heidegger sur Van Gogh » (1968) ; Jacques Derrida : « RESTITUTIONS de la vérité en pointure » (1977). 9) cf Archives inactualités et acribies, 1er et 3 Juillet 2018 ; 10) (1844-1845), la chaussure chez les anciens et les modernes ; 11) boutique de bottier (dixit l’auteur lui-même) ; baquet plein d’eau pour détremper le gros cuir ; 12) toutes ces remarques in Le gniaffe ;
13) Jean-Luc Steinmetz et Alain Borer, co-responsables d’un élégant petit livre, typographie et présentation impeccables, mise en page sans colle, sans agrafe, sans couture ; le premier, auteur des prélection, notice et glossaire, le second de la postface ; contributions supplémentaires à leur travail d’inventeur et d’éditeur. Mille grâces leur soient rendues, et à l’amitié qui me fait, ce jour, tenir par devers moi l’un de ces cinq cents exemplaires.

nocticola
Écrire la nuit
éclaire le matin
de loin
— Qui défroissera les nuages d’acier que la pluie enfermée tant grise retient ? que devient le brouillard si la fumée l’enclot l’hiver ? pourquoi l’ombre qui tombe d’un ciel clair ne monte-t-elle pas plutôt de la terre brune et noire, du sol obscur d’où s’élancerait la nuit jusqu’au ciel illuminé jusqu’à l’aube future, jusqu’à demain ? —
*
Quand la chute des mots sur les feuilles d’automne cessera-t-elle ?
*
d’une longue voix jeter sa parole à l’infini dépendu dans le vide
se balancer doucement et triste,
dérouler un sourire dans la nuit bleue —
*
Seuls les mots
font pousser aux arbres
leurs feuilles d’or
*
l’avancée lente du mot sur la page,
ses boucles ses clôtures ses départs ses retours
jusqu’à chuter dans l’infinité des possibles,
suspendu à son fragile point d’usure.
*
La pomme mange le pommier
Chaque coup de dent
Est un coup de scie
*
tombées dans l’abîme
mes pensées désarticulées
résonnent
Petite chronique d’une disparition inquiétante :
— d’un lambda âgé, de date et de lieu de naissance inconnus, vivant dans un isolement quasi-total, ne recevant que de très rares visites, n’ayant pas de famille proche, et duquel ses voisins immédiats s’étaient peu à peu éloignés. Mais, s’inquiétant de ne plus l’apercevoir depuis un long moment, car il lui arrivait encore de sortir exceptionnellement, l’un d’eux a fini par donner l’alerte.
Le premier rapport d’enquête montre :
— que l’affaire se révèle plus complexe qu’elle n’en a l’air. De nouvelles perquisitions ont établi avec une quasi-certitude que le disparu n’a pas quitté les lieux de manière délibérée ou préméditée. Les fouilles ont permis d’apporter des preuves irréfutables : des sacs, des sacoches, des étuis, des trousses, des cartables, des valises, tous emplis d’objets de première nécessité –feuilles, crayons, gommes, coupe-papier– bien qu’un peu démodés, ont été retrouvés intacts. Des réserves de nourriture et même une recette en cours, la liste de ses ingrédients en évidence. Et partout, de longueurs et contenus hétéroclites, des listes, des listes, des listes... des nomenclatures, des énumérations, index et répertoires.
L’analyse de l’expert en profilage.
— Selon nous et contrairement à ce qu’il laisse paraître, le disparu est raffiné. Ce qu’il entasse et compile révèle une personnalité très organisée mais illisible à première vue. Même chose pour une vie qui n’est pas si solitaire qu’on pourrait le croire. Le disparu est en harmonie parfaite avec son intérieur, il n’est guère plausible qu’il soit en fuite ; en revanche, s’il a été, pour des raisons que l’enquête doit établir, sorti de chez lui parce qu’on l’en a chassé –scénario envisageable– il faut savoir 1) qu’il est mal adapté, voire inadapté à la survie loin de ses repères 2) qu’il est, en conséquence, en danger absolu.
L’inventaire :
— on a trouvé et rapporté comme pièces à conviction pour étayer la thèse d’un enlèvement, qui ne semble pas crapuleux à ce moment de l’enquête, des liasses de toutes tailles, formes, épaisseurs, agrafées selon une logique qui reste à établir. Des noms propres, des mots, des dates, des intitulés… dans leur très grande majorité inconnus. Certains pas plus grands qu’un marque-page, des pense-bêtes, des notes manuscrites griffonnées à l’encre rouge et à la hâte. Entourées, soulignées, elles font parfois doublons. Sur des tables, dans des tiroirs, il y en a partout. Il faudra demander aux services du décodage si l’on peut en déduire quelque logique pour étayer un portrait psychologique plus précis du disparu. Et si la circonstance véreuse n’est pas retenue à ce jour, parce qu’ils n’ont trouvé rien de précieux ou qu’on puisse refiler dans ce fatras de papier et de gribouillis, les inspecteurs-enquêteurs sont à la recherche d’un mobile sans voir qu’il se tenait, là, sous leur yeux.
Nouveau rapport d’enquête :
— après plusieurs semaines de travail intense et stérile, alors qu’aucune piste ne semblait se dessiner, cette disparition inquiétante devint une cause désespérée, d’autant que personne ne venait aux nouvelles. Jusqu’à ce qu’un appel anonyme fît bouger les lignes. On venait de repérer Impasse des Absomphes, un petit groupe d’inconnus, étiques et squelettiques, quasi invisibles tant ils s’entassaient dans le coin le plus obscur et reculé de leur cachette. Il fallut bien de la patience pour les approcher et les attirer à l’air libre. Et commencer enfin les interrogatoires. D’abord les identifications.
Conclusions provisoires :
— si chacun se souvenait de son nom, aucun ne pouvait en produire le certificat d’authenticité. En revanche, tous connaissaient celui de leur ravisseur, mais restaient incapables d’expliquer ce qui l’avait amené à les faire disparaître sans verser de sang mais par élimination progressive et certaine par défaut de soins et sans que personne ne s’en aperçoive, puisque personne ne les fréquentait plus. On apprit que le recherché faisant l’objet de l’enquête en cours venait d’arriver dans la tanière –les officiers ne savaient pas au juste quel nom donner à cet endroit qui tenait de la fosse, du souterrain, de l’oubliette, de la planque et du refuge. Ils avaient pour seules certitudes que tous ces malheureux n’y étaient pas venus de leur plein gré et qu’ils étaient voués à une mort certaine, malgré les imprévisibles et fortuits passages de rarissimes promeneurs égarés et toujours pressés ; car l’Impasse des Absomphes était inconnue de tous, on y arrivait toujours par erreur de parcours.
Finalement, le coupable fut retrouvé grâce au portrait-robot que les reclus dressèrent ensemble. Il s’agissait d’un certain Larousse, descendant d’une famille respectable du XIXème siècle, dont la 1ère devise, Je sème à tout vent, fut prise au pied de la lettre par le dernier rejeton de la dynastie qui s’illustra à dilapider les trésors et les traditions de ses ancêtres, sans vergogne, puisqu’il accepta pour la plus récente des solutions à sa propre survie qu’on le débarrassât de toutes les bouches inutiles, ce qui dans le jargon professionnel s’appelle des entrées, et même des adresses. Il ne serait pas fier, l’ancêtre, de savoir que cent soixante ans environ après sa première publication, on abandonnait brutalement les plus belles d’entre elles qu’on disait périmées et même vieux jeu. Le premier des Larousse, Pierre, n’aurait jamais cédé : consentir au goût du jour, peut-être, sacrifier les Anciens, non.
L’interrogatoire de l’héritier fut ardu. Evidemment, il nia les abandons. Pire, il tenta de faire gober la thèse du suicide collectif, avant qu’on ne lui fasse comprendre qu’il avait intérêt à changer de ton et de manière : on n’instruisait plus une affaire de disparition, mais de manque volontaire de soin, de non-assistance, de mise en danger par cessation délibérée de protection, le tout en la circonstance aggravante de la préméditation. Les enquêteurs spécialisés avaient retrouvé des archives, et lui mettaient sous le nez les noms d’autres disparitions non élucidées : Besaigre, Havir, Mohatra, Poétereau… qu’un stagiaire désœuvré avait classé par ordre alphabétique, et le dernier arrivé dans le dossier, Amphigouri celui qui fit repartir l’enquête, il était en haut de la pile. Les coïncidences étaient trop grandes, et, c’est bien connu aucun limier ne croit aux coïncidences… Aussi, le dénommé Larousse, le petit de la famille, finit par craquer pendant les confrontations. Il avoua le mobile principal de ses forfaits criminels, la lâcheté, non sans expliquer de manière confuse et peu convaincante, que ce n’était pas si simple quand même, ce qui fit grommeler le dernier-disparu-retrouvé : propos amphigouriques, et amusoire pour la galerie marmonnait-il. Sauf que la galerie n’était pas n’importe qui. Spécialement créée pour réprimer les crimes de lèse-dénomination, on lui avait promis des pouvoirs étendus d’investigation : arnaques lexicales, abandons de vocabulaire, malversations syntaxiques, usurpations d’identité grammaticale, faux et usages de faux sémantiques, tromperies étymologiques et autres atteintes à la dignité de la langue française, sans oublier les résidents sans titre de séjour. Mais la brigade ad hoc et ses capitaines, dans la réalité, manquaient cruellement de moyens pour éradiquer la criminalité linguistique sous toutes ses formes, malgré les promesses et les beaux discours de sa hiérarchie.
Précisions :
— toute ressemblance avec des faits avérés est volontaire, délibérée, assumée, intentionnelle, préméditée et méditée, résolue, car l’idée de cette parabole m’est venue par un articulet recensant les mots disparus de l’édition 2019 –parue en 2018- du Petit Larousse.* Mon encre et mon clavier, à défaut de mon sang, quoique… n’ont fait qu’un tour. Disparus ? et que peuvent bien devenir des mots disparus… Ce malheureux apologue est l’expression légère et de mon désespoir profond et de mon insondable colère à l’endroit de la Maison Larousse, et les coquins s'inspirant entre eux, elle n'est point la seule à contribuer à cette opération de destruction massive. Massive et silencieuse. Honte à elle. Il eût fallu, pour maintenir à l’attention de quelques pauvres-demeurés-totalement-hors-de-leur époque, des entrées inusitées, obsolètes, passées de mode, inactuelles en un mot, mais sans épaissir le volume, se passer de meuf, keuf, ubérisation, spoilier et autres joliesses tellement raffinées… invendable !
L’Impasse des Absomphes n’existe pas, bien sûr, aussi à ce joli mot oublié, perdu, disparu, rimbaldien, cette sauge des glaciers, l'absomphe ! j’ai voulu redonner un peu de souffle.
Enfin, quelle peine pour l’héritier Larousse déclaré coupable de tous les faits reprochés ? trois fois rien : être montré du doigt publiquement – mise à l’index– par un bandeau, un bracelet d’information sur les précautions d’usage d'un objet dangereux pour la santé publique. Ce qui est bien peu et n’est à ce jour toujours pas appliqué. Preuve qu’on est bien dans une fable !
*dont le délicieux amphigouri ; j’ajoute que je ne pratique jamais ni le grand ni le petit Larousse. Il y a tellement mieux !
Le Peuple, la foule (suite et fin)
La nuit portant conseil* je reviens avec le sentiment du devoir inaccompli. Même si l’inachèvement, toujours en embuscade dès qu’on pénètre en terre antique grecque, est un peu le prix à payer, des précisions et des remarques me tirent par la manche avec insistance. Il les faut reprendre, remettre l’ouvrage sur le métier. Préciser encore.
Que démocratie soit le nom par lequel on désigne en grec le pouvoir des citoyens en l’Athènes du Vème siècle avant JC, ne suffit pas. Qu’ainsi soient exclus environ les deux tiers des habitants et résidents de la Cité, c’est une affaire entendue ; mais le disant, on oublie cette positivité paradoxale et demeurée la plus féconde de la pensée politique moderne, celle à laquelle il faudrait toujours se référer, qui se joue des époques et des conditions historiques, qui les dépasse et les déborde : l’indépendance. A l’égard de toute forme d’intérêts bien sûr mais aussi des privilèges, voire des dons et des talents. Démocratie, le terme exige toute renonciation à des avantages, de nature, de naissance, par acquisition ou par transmission, mieux encore, il exige qu’on n’en ait point du tout. On n’est pas disposé à gouverner parce qu’on se montre capable de force, de ruse, qu’on hérite d’un nom, d’un titre, d’une charge, ni même, dans certains cas, parce que d’autres citoyens vous en estiment capable ou digne … où l’on retrouve l’effet pervers de l’enseignement sophistique, au point de départ censé éduquer la jeunesse dorée d’Athènes à la bonne pratique de la parole publique –la rhétorique– en fin de compte les formant à un autre champ de bataille que celui des armes, des prébendes ou des avantages consentis, celui de la corruption plus insidieuse et moins visible de ceux qui n’ont pas bénéficié d’un tel enseignement, les autres citoyens un peu moins riches, un peu plus pauvres ; puisqu’on ne parle pas ici des femmes, des esclaves –pourtant très souvent précepteurs des enfants de familles nobles, donc éduqués eux-mêmes– ni des étrangers, le poumon de l’activité commerciale athénienne. Inutile d’insister bien sûr sur l’inanité de toute accession aux charges publiques par décret d’une divinité supérieure, serait-elle plurielle en cette époque furieusement polythéiste ; si les Grecs en général doivent dévotion aux dieux de leur Cité, les Athéniens de l’époque démocratique ne leur confèrent aucune responsabilité en matière politique. Que reste-t-il alors qui soit nécessaire mais suffisant pour qualifier de démocratiques des institutions et une Constitution, à Athènes, conséquemment ailleurs et en d’autres temps ?
Sans en reprendre la complexité, il ne faut pas omettre de rappeler que les guerres médiques –gagnées surtout sur mer, merci Thémistocle, stratège d’extraction modeste– ne furent pas pour rien dans l’affermissement ou la consolidation de la jeune démocratie voulue par les réformes de Clisthène, après Solon, et suivies de celles de Périclès, par une sorte de lissage de tous les citoyens, quelque que soit leur niveau social pour le dire en termes contemporains. Les plus hautes fonctions, depuis toujours et encore à l’époque dans les autres cités, réservées aux plus riches ou aux plus influents, sont dorénavant accessibles aux citoyens athéniens modestes, voire moins. La pauvreté ou la gêne ne peut et ne doit faire obstacle pour remplir des charges publiques, des indemnités y pourvoiront. On peut appeler cela une abolition des privilèges dont l’exemplarité dans les faits s’affiche régulièrement par l’instauration de tirages au sort qui assurent le panachage des désignations** –sauf les militaires. Si l’on ajoute que toute fonction charge ou gestion ne peut être exercée au-delà d’un an*** on commence à dessiner à gros traits le portrait d’une ville d’il y a environ 2 500ans qui s’extrait par son génie propre de l’atonie et de la passivité de ses voisines et concurrentes, parfois ennemies. Que la parole fût publique, qu’elle fût prise en compte et même qu’elle fût souveraine est une mutation –et non un simple changement– une rupture anthropologique****. Sur une terre où les dieux depuis toujours ont eu le premier et le dernier mot, le discours des mortels devient signifiant, il peut même dire le vrai. Ou le faux. Les mortels sont-ils encore plus roués que les divinités les plus retorses ? peut-être bien. Mais de ce constat on peut tirer une conséquence. Si la parole est humaine par essence, les hommes doivent en user pour eux-mêmes, pour réguler l’hybris, ὕϐρις, génératrice de désordre et de troubles qui rendent impossible la vie en commun sauf à subir la démesure d’un tyran, d’une caste, d’un groupe. Athènes invente une idée nouvelle qui fera principe pour les siècles à venir, l’égalité des droits politiques et des pouvoirs civiques pour tous les citoyens. Euripide fait dire à Thésée dans Les Suppliantes : « sous l’empire des lois écrites, pauvre et riche ont les mêmes droits. Le faible peut répondre à l’insulte du fort, et le petit, s’il a raison, vaincre le grand. »
Mais les dangers guettent et menacent de l’intérieur la fragile démocratie athénienne et par extension toute démocratie : démagogie et ochlocratie qui se nourrissent l’une de l’autre. De la première Platon a analysé les risques et donné le remède. Toutes les opinions n’ont pas même valeur eu égard à la charge contenue de vérité qu’elles transmettent ; aussi, ceux qui font profession d’enseigner des techniques d’éloquence pour mieux emporter l’adhésion du public sont les ennemis de la Cité, ils sont les contempteurs du peuple qu’ils prétendent servir et le transforment en foule. De la démocratie bâtie sur le principe selon lequel les lois comme conventions civiques doivent recevoir l’assentiment du peuple (des citoyens) et que les citoyens sont égaux devant elles, on passe à la démagogie, la recherche du consentement de la foule par simple complaisance, accord ou désaccord à ce qui convient, ce qui plaît, ce qui arrange, qui peut aller, toutes choses étant équivalentes au gré du vent, –c’est le risque que Platon ne cesse de dénoncer, et à l’ochlocratie, la prise de pouvoir par la foule bernée par des discours ambitieux. L’ochlocratie faisant à court terme le lit de la tyrannie : qui se laisse abuser une fois, se laisse abuser toujours. Anacyclose.
[*et la dégustation d’une tarte à la bergamote aussi merci F&F toujours aussi attentionnés…]
**expression de Jacqueline de Romilly ; ***à l’exception des stratèges, ce qui se comprend ; ****ce qui ne veut pas dire qu’il y eut soudaineté dans ce changement bien sûr.
Reprenons,
(Après une interruption due au matériel informatique qu’il fallut remplacer… ci-dessous, la suite annoncée de l’article précédent.)
et résumons la situation. En quoi la démocratie pourrait-elle bien mener à la négation du politique, son avilissement, sa déliquescence, puisqu’elle en est, selon l’opinion communément partagée mais assurément fautive, l’excellence. La preuve ? née en Grèce il y a fort longtemps, elle serait la seule à proposer le gouvernement du peuple par lui-même, ce qui garantirait contre l’arbitraire ; et conséquemment la seule forme de pouvoir capable d’assurer la justice et l’égalité pour tous. Cette affirmation portée de générations en générations comme un article de catéchisme et rabâchée comme un mantra, n’est que l’expression d’imprécisions, d’ignorances et même d’erreurs, renforcée par le sentiment, si étrange aux yeux de quelques-uns, que tout ce qui procède de l’Antiquité hellène est aujourd’hui bon pour nous.
On ne revient pas sur l’insupportable méprise -soyons aimable- qui fait croire aujourd’hui encore, que de tout temps la Grèce fut un pays-nation avec Athènes pour capitale. C’est tellement pratique ! mais tellement faux. On ne revient pas non plus sur l’absence de repères chronologiques les plus élémentaires, qui, non seulement éviterait de croire qu’Homère, Socrate et Epicure eussent pu être contemporains, comme si Montaigne, Rousseau et Bergson qui, étant français tous trois, eussent pu avoir des points communs à servir pour l’éternité à venir. Sinon par l’usage partagé d’une langue, le seul critère rapporté à la Grèce qui puisse être retenu, précisant bien qu’il ne s’agit pas pour autant d’un référent fixe, constant ou immuable. On ne revient pas non plus sur l’ahurissante inconnaissance de la question de l’esclavage, -un article à soi seul- qui ne se confond pas avec l’esclavagisme, ni sur le statut des femmes, libre mais non citoyen, à moins de rappeler qu’en France, elles obtinrent le droit de vote en 1944, l’exerçant pour la première fois un an plus tard, et l’affranchissement de l’autorisation de leur époux et maître pour travailler et gérer leur propre compte en banque en 1965… ni sur le refus du droit de vote pour les étrangers -sauf pour les scrutins européen et municipal mais depuis 1992. Si comparaison n’est pas toujours raison, ce peut être sacrément instructif en ce cas…
Redisons fermement ce que le terme démocratie, en grec et en Grèce représente : le gouvernement, à Athènes et dans ses colonies, au cours du Vème siècle avant Jésus-Christ par consultations, scrutins, décisions, votes et avis venant exclusivement des citoyens, élus ou tirés au sort c’est selon,* c’est-à-dire des habitants majeurs et mâles, de parents eux-mêmes citoyens athéniens ; ou si l’on préfère, l’exercice du pouvoir politique d’une minorité de la population dans cette Cité-Etat, divisée en nombreux dèmes**, présidés chacun par un démarque - δήμαρχος ; qu’il s’agisse de financement, ou de finances tout court, des cultes qui sont civiques rappelons-le, des pouvoirs de police, de justice et tout ce qui relève de la vie en commun. Aussi, si l’esprit, l’intention, la réalité sont bien ceux-là –nous ne revenons pas sur les modalités pratiques, ni même sur les raisons historiques qui en ont permis l’établissement***, comment peut-on trouver en son temps, des détracteurs de la démocratie dont certains arguments méritent pourtant aujourd’hui d’être connus.
On ne prendra jamais assez de précautions pour aborder la question sous cet aspect critique –au sens philosophique et étymologique de ce terme– tant sont enkystées dans nos esprits trompés, l’illusion et l’opinion funestes selon lesquelles il ne peut y avoir de gouvernement du peuple par lui-même, censément de démocratie, qu’enclin à la vérité. Avec une majuscule. Ce qui est exactement la hauteur à laquelle Platon place le débat. Le disciple de Socrate, celui de qui, avec Xénophon, on tient les propos du Maître, celui qui les approfondit et précisa, celui qui fit œuvre, celui qui fut platonicien sans jamais le savoir. Oui, Platon est un critique virulent de la démocratie athénienne (pléonasme) celle qui fit comparaître, juger et condamner à mort le vieux Socrate qui refusa l’alternative du bannissement, de l’ostracisme, car il y a pire que mourir : trahir la Cité à laquelle on doit tout. Relire le Criton. D’aucuns préfèrent jeter Platon aux gémonies ou plutôt aux enfers, estimant que se payer un philosophe académique fait une victoire à nulle autre pareille de leur insoumission sur la tradition, piètre succès acquis sur le pliement, voire la torsion des textes et des contextes. Car la question politique est la question philosophique par excellence. Qui pour assurer que la justice soit juste, ce qui assure à son tour que la vie en commun soit possible, pour garantir qu’elle ne soit pas une illusion de justice, une justice apparemment juste, qui n’en a que le ramage et dont on se contente d’admirer le plumage ? qui ne comprend pas que le cœur du raisonnement platonicien est là, ne peut entrer dans sa critique, son analyse.
La vie intellectuelle, et particulièrement la philosophique, est intense et foisonnante à Athènes en raison de plusieurs facteurs conjugués : la liberté de circulation des biens et du commerce obligeant autant à l’autonomie qu’à l’aisance dans les rapports humains qu’une éducation de qualité doit promouvoir en vue du bien commun, tout ce qui favoriserait l’individu seul va à contre-sens de cette exigence et la vie privée ne peut être le critère des règles de conduite ni de raisonnement qui mènent nécessairement aux conflits d’opinions. On peut dire, bien que trop rapidement, que si la génération antérieure de penseurs a affranchi l’homme grec de ses repères mythiques, celle de Socrate l’a exonéré de sa dette mystique à l’égard de l’organisation de la Cité, ce qu’Aristote parachèvera****.
Socrate, citoyen athénien, sait ce que sa ville natale autorise à son esprit sédentaire : la déambulation et la parole échangée et publique avec ses concitoyens. Il est une figure de plus en plus célèbre de l’agora et des espaces dédiés à la conversation, aux rencontres, aux débats ; et les controverses mais aussi les disceptations et même les dialogues ont libre cours. Soit entre des jeunes gens curieux, fils de riches citoyens avides d’en découdre, soit avec quelque sophiste de passage en ville, soit les deux car échangeant avec les premiers, il croise aussi le fer avec les seconds qui en sont souvent les professeurs particuliers grassement rémunérés pour leur apprendre la rhétorique –leur spécialité– dont il faut maîtriser toutes les ficelles si l’on veut, pour les charges qui le requièrent, se faire élire, ou, a minima être influent. Voilà bien un premier niveau de critique. La sophistique ou l’apprentissage de l’efficacité oratoire se monnayant au plus offrant est un savoir (l’étymologie est la même, on l’entend…) réservé aux plus riches. Sur ce point, Socrate fait souvent valoir qu’il faudrait que les sophistes ne se fassent pas rétribuer du tout, il y a de fréquentes réprobations à ce sujet dans les textes platoniciens, même s’il ne cache pas une admiration ambivalente pour le plus riche et célèbre d’entre tous, Protagoras. Protagoras faisait un tabac en ville. Il enseignait qu’il n’existe ni absolu, ni certitude, ni vérité immuables, et comment s’arranger et consolider efficacité et relativisme. Montrer que l’on peut dire ceci en même temps que cela, puisque tout change sans cesse et qu’on ne peut être sûr de rien, il faut savoir se débrouiller de tout. Gorgias venu tout droit de Sicile affirmait pouvoir soutenir toute cause, et la réfuter tout autant. Mais s’il convient de convaincre, il faut le faire par les moyens de la séduction oratoire plutôt que pour des raisons immuables qui risqueraient de vous nuire ou de vous affaiblir à terme, car, chacun le sait, la séduction a pour avantage de n’avoir point besoin de démonstration. Ni donc de raisonnement.
C’est très exactement le contraire de l’esprit socratique, tel que Platon l’a entendu et retenu : si la politique –la vie commune dans la Cité d’Athènes et dans les dèmes– est à la merci de l’orateur qu’on vient d’entendre, ou de celui qui aura plu pour des raisons individuelles, privées, ou immédiatement pratiques, alors, oui, la politique est un danger pour le politique. Les contingences des uns ou des autres l’emporteront sur l’intérêt de tous, et l’on verra des arguments fallacieux ou partiaux prendre le dessus ; la Vérité, seule vertu qui peut rassembler, sera sans force face aux vérités occasionnées par les circonstances, et comment, dans ces conditions, ne pas passer de ce qui n’intéresse que soi à ce qui, en conséquence, va nuire aux autres. La question de la Vérité, contrairement à ce qu’on pourrait penser, n’est pas anodine ou dépassée en politique. Il en est du Vrai comme du Beau, par exemple, un peu plus facile à illustrer : comme toujours Platon fait de Socrate l’ingénu de service, qui plaidant l’ignorance demande à l’un de ses interlocuteurs de lui dire ce qu’est le Beau. L’autre répond désignant une belle femme, un bel objet etc. ce que Socrate récuse fermement. Désigner quelque chose de beau, en lieu et place du Beau, procède de deux erreurs majeures : présupposer connu le Beau qui fait l’objet de l’interrogation, et donner à un exemple une valeur universelle. La discussion tourne court ou plutôt l’embarras dans lequel Socrate jette le prétentieux tourne, pour les siècles à venir, à l'avantage du philosophe. Ainsi de la Justice qui ne doit pas reposer sur des critères seulement vraisemblables, ou vrais dans telle ou telle circonstance, ni même parce qu’un grand nombre s’y est rangé, cela s’appelle la tyrannie de l’opinion ; ce n’est pas parce que des arguments sont majoritairement partagés qu’ils sont vrais, mais parce qu’ils sont vrais qu’ils doivent être partagés par tous. Platon n’oubliera jamais qu’un Sage peut être condamné par une assemblée de non-sages et fondera toute sa critique de la démocratie sur le désaveu de la parole avantageuse pour quelques-uns aux dépends de la vérité pour tous. La Justice qui doit mettre les citoyens à égalité de chance lors d’un procès, ne peut être soumise à des artifices rhétoriques, ce qui reviendrait à la détacher de sa nature même, en la renvoyant de façon insidieuse et immorale à une autorité qui ne vient pas d’elle-même. Ainsi de tout ce qui concerne la vie des citoyens, les arbitrages, les propositions ou les décrets, les règles ou les règlements. La parole libre du citoyen athénien ne devant servir qu’au bénéfice de tous, elle ne peut reposer sur les critères artificieux du maniement efficace des mots.
Comment se prémunir contre le danger sophistique, se protéger contre le beau parleur, débusquer celui qui tient à l’emporter par les raisons déraisonnables de son habileté ? comment être sûr que la parole publique entre les citoyens en vue d’établir des droits, d’élaborer des décisions, de juger des actes, ne sera pas confisquée par des experts autoproclamés qui atténuent de manière indolore la responsabilité civique exceptionnelle des Athéniens ? comment ne pas avilir le politique dans la politique ? La réponse de Platon tient en un mot : philosophie, ce qui signifie éducation. Education à la dénonciation des savoirs préalables et passivement transmis, éducation à poursuivre les opinions toutes faites et confortables, éducation à la constitution de la vérité et non à la préférence du vraisemblable. Socrate le paya cher qui ne voulut pas se défendre devant les accusations portées par Métélos (du dème de Pithos), c’eût été leur concéder quelque valeur. Soixante voix sur 501 lui manquèrent pour être acquitté, lui l’homme si respectueux des dieux, du crime d’impiété. Il n’est pas improbable que ce fût l’accusation de corruption de la jeunesse la plus déterminante, comme enseignant, comme éducateur, Socrate apprenait gratuitement aux élèves des Sophistes à se méfier de leurs beaux discours….
Aujourd’hui on se souvient de l’injustice majeure plutôt que de ceux qui l’ont prononcée, plus de Socrate que de Mélétos.
*la littérature historico-démographico-sociologique sur le sujet est dorénavant parfaitement constituée. ** on porte pour nom celui de son père, le patronyme, accolé à celui de son dème. *** disons juste, pour les curieux, qu’il faut s’intéresser de très près à la constitution de Clisthène.****comme le montre fort bien et dès le titre Aristote et les choses humaines, Pierre Rodrigo dans son analyse de la pensée politique du Stagirite qui fait autorité.
Démocratie, que de sottises on a dites en ton nom !
De deux choses l’une : ou ceux qui nous ont précédés ont été des abrutis parfaits, ou ils sont à l’origine de tout ce qu’il y a de bon en ce monde. Ainsi, la Grèce antique que nous prenons pourtant et à juste titre pour la terre-mère de tous les mythes qui irriguent encore nos représentations symboliques et notre vocabulaire, la Grèce, comme il est dit avec une assurance qui coupe court à tout commentaire, la Grèce a inventé la démocratie ! affirmation elle aussi de l’ordre du mythe, si l’on veut bien s’entendre, cette fois, sur l’acception barthésienne : la Grèce antique est à la démocratie ce que la France est au steak-frites, une formule…une parole au sens d’un énoncé, exactement une (ou la) doxa, l’image la plus usée et/ou la plus répandue comme signe. Affirmer à tout va que la Grèce a inventé la démocratie c’est donc un peu comme dire que la francité se retrouve dans la frite. Il va falloir en finir avec cette concrétion d’erreurs dont le paradoxe suprême est de l’enraciner dans une terre elle-même mythologique.
Dans l’introduction à la traduction française du livre de Moses I.Finley Démocratie antique et démocratie moderne, l’immense helléniste Pierre Vidal-Naquet écrit qu’il ne faut pas confondre le politique [son essence, sa nature intelligible ou conceptuelle selon Platon] et la politique [ce que l’on en voit ou en sait, ses manifestations empirico-sensibles]. Celle-ci, dit-il, est une activité envahissante et, à la limite, destructrice de celui-là. Superbe ! et de proposer l’hypothèse de travail suivante : la démocratie, comme concept politique*, relève bien de la politique, elle est, en conséquence, une condition de possibilité de l’affaiblissement au moins, de l’anéantissement au plus, du politique comme organisation de la vie commune.
Ainsi exprimée l’intention peut choquer, il suffirait de l’assécher, la racornir, ce que fait toujours la doxa, toujours coupable d’éviter les difficultés mais pas les raccourcis. Or, penser c’est tout le contraire, c’est déplier devant soi, pour soi-même d’abord, pour d’autres seulement après, les itinéraires de raisonnement suivis. Y compris leurs errements, en cela le philosophe est toujours enfant de Descartes, serait-il lecteur de Platon. La démocratie n’est pas née en Grèce, stricto sensu, et elle ne signifie pas que le peuple, au sens moderne de population, détient le pouvoir, ou toute formule approximativement semblable. Et c’est bien par l’approximation –étymologique, historique, philosophique– que de telles affirmations ont pu prospérer et d’autant mieux que les liens ont été rompus qui les retenaient à des développements précis, référencés, argumentés. La démocratie de la Grèce antique qui nous guiderait comme la Liberté le peuple, voilà bien un mythe moderne, autant dire un objet de pensée magique.
Vidal-Naquet s’étonne du titre du livre pour lequel il accepte de rédiger une Préface. Et si, de la démocratie grecque à la nôtre il n’y avait aucune raison valable de chercher les points de comparaison ? la question n’est pas provocatrice mais fondatrice, on devine que le travail qui suit va s’en saisir et la réduire. D’autant qu’elle ne date pas d’hier mais d’avant-hier, à savoir la Révolution française qui a connu dans les plus virulents de ses dirigeants, ou postulants dirigeants, l’une des sources actives d’une identification d’autant plus béate à certaines catégories pédagogico-politiques de la Grèce antique qu’elles étaient assez mal digérées : la question de l’éducation spartiate rapportée à sa possible application-adaptation à la France révolutionnaire, ou plus étonnante encore, la lettre d’un rédacteur de la Constitution de 1793, aux fins qu’on lui procurât un recueil des lois grecques pour s’inspirer de celles de Minos, le législateur crétois. Nous en avons un besoin urgent écrivait-il !
Plus lucide, mais environ 50 ans plus tard** Marx pointera l’écueil, qu’il appelle une erreur colossale : l’État antique réaliste et démocratique ne peut servir de parangon à l’idéal de l’État moderne. De parangon certes, mais de symbole ? si nous en appelons à vous, vainqueurs de Marathon, de Salamine *** est-ce en raison d’un simple culte de l’antiquité, un habillage en quelque sorte, ou d’une connaissance fine et autorisée ? Vidal-Naquet affirme que les orateurs révolutionnaires étaient loin d’être érudits dans les études grecques, à part peut-être Camille Desmoulins ; une remarque qui s’amplifie à l’époque contemporaine, et nous ramène à la dimension mythologique et magique, c’est-à-dire hors de raison, de ce double lieu commun de l’ignorance : la Grèce a inventé la démocratie et toute lutte politique consiste à en retrouver l’esprit fondateur et natif, et à s’en réclamer !
Sauf que :
il n’y a pas d’État grec, d’une part, et d’autre part, si l’on mesure la démocratie à partir de la valeur-étalon de l’égalité, il y a une insoluble contradiction, puisque les habitants d’Athènes, unique cité du Vème avant JC à avoir institué la démocratie, ne sont ni libres ni égaux en droit, mais ses citoyens seuls. Ce qui n’est le fait que d’une minorité. Il faut prendre la question autrement ;
sans remonter trop loin, ou si l’on préfère, se rapprochant des temps où Athènes –ses territoires, ses quartiers, ses dèmes tant urbains que ruraux et ses colonies– développe une stupéfiante activité économique, qu’elle doit d’ailleurs à ses conquêtes (la Sicile, la Cyrénaïque, les pays égéens…), ces échanges n’étant pas seulement de survie, mais immatériels dirait-on aujourd’hui. L’ordre marchand ne peut se faire sans certaines garanties de paix, de libertés, de droits. Et si la Grèce des VI et Vèmes siècles est représentée par l’ensemble des terres et des territoires, seraient-ils lointains ou séparés les uns des autres, où l’on parle grec, ce n’est pas rien, mais ce n’est pas tout. Restent, si l’on peut dire, des cités parfois réunies par des conventions, des traités –on en a retrouvé quelques-uns– voire des garanties d’hospitalité les unes envers les autres, pour les citoyens qui vaquent à leurs affaires hors de chez eux, c’est la tradition des proxènes, πρόξενεζ. À cet égard, le cas d’Athènes est exemplaire et unique, quand, partout ailleurs, l’oligarchie est le régime politique le plus fréquent, ou ses variantes, aristocratie, ploutocratie, gérontocratie, simples variations sur le thème : il n’y a de légitimité à gouverner la cité que si l’on est le plus riche ou puissant, ou d’ancienne famille, ou ancien tout court. Le tyran dans cette liste n’apparaissant pas comme le pire, le mot grec désigne étymologiquement, le pouvoir d’un seul certes, mais acquis par ses mérites et forces militaires propres, ce qui en fait le favori du petit peuple qu’il défend et protège.
Athènes, remarquable par son développement, ses institutions, son évolution, et par Solon, le réformateur sur lequel la documentation est assez sûre ; Solon dont on rapportera ce point pour se faire une idée de l’essentiel : il retira le droit des créanciers de réduire en esclavage leur débiteur insolvable, ou un membre de sa famille. Ce qui en dit long sur ce qu’on appelait et pratiquait encore dans la France du 19ème siècle, la contrainte par corps. Pour Athènes, l’effet démographique et économique fut patent. Et Solon multiplia les innovations, sur le plan juridique et constitutionnel, dans la disposition pour chacun de ses propres biens par exemple, et le renforcement de l’ordre judiciaire, aux dépends des règlements transactionnels entre familles. Au tribunal des héliastes, le jury se compose de citoyens tirés au sort, sans distinction de fortune ni de classe.
Ce dernier point est essentiel : sans distinction de fortune ni de classe. Il s’étend dans l’Athènes que l’on appellera désormais démocratique sur ce seul critère, à toute la vie politique, sous la réserve inconditionnelle de citoyenneté, être né de parents athéniens citoyens eux-mêmes, être homme. Exeunt les femmes, les étrangers (métèques), les esclaves. Ce qui fait une population évaluée entre 20 et 40 000 démotes, habitants des différents dèmes… La démocratie athénienne quand elle fut vivace mais brève, signifiait qu’on peut être pauvre [certains commerçants ou artisans du dème du Céramique, par exemple**** ou agriculteurs l’étaient] ou de famille non noble, pourvu qu’on soit citoyen, soit environ et seulement 20% de la population, pour être appelé à rejoindre les (autres) dirigeants de la Cité, ou pas. Ce qu’il faut comprendre et retenir dans ce tableau à gros traits (pardon Denis, pardon Stéphanie) c’est qu’il n’y a rien d’autre dans cette affaire que le sens d’un mot. A tel point que Platon, excusez du peu, s’insurge contre la démocratie comme option politique, qui rend possible le gouvernement de n’importe qui, n’importe comment… Une explication de cette formule lapidaire et moralement inacceptable est évidemment nécessaire, je m’y emploie dans l’instant même, et pour bientôt. La critique de Platon mérite un examen précis, en particulier du rôle des Sophistes, à ses yeux les véritables ennemis de la Cité, alors qu’aujourd’hui, ils passeraient peut-être, sûrement, pour les chantres de la liberté d’expression…
*je rappelle à ceux qui ne suivent pas que le terme concept usé et râpé à toutes les sauces de nos jours –comme le parmesan– sous ma plume trempée à l’encre de seiche des Grecs d’avant Socrate et des suivants, ne signifie jamais, jamais une opinion, un avis, une conviction, une idée, une trouvaille, un truc qui nous passerait par l’esprit… c’est même précisément le contraire. ** 1845, in La Sainte Famille. *** Isnard, un Girondin, 1793. ****nom d’un quartier d’Athènes aujourd'hui encore -très couru des voyages scolaires !
astronomiquement vôtre*
A chacun je souhaite,
Des dizaines de livres

Qui pèseront des centaines de kilos

Contiendront des milliers de pages
Faites de millions de phrases

En des milliards de mots
Et des billions de fois
Les 26 lettres de l’alphabet,
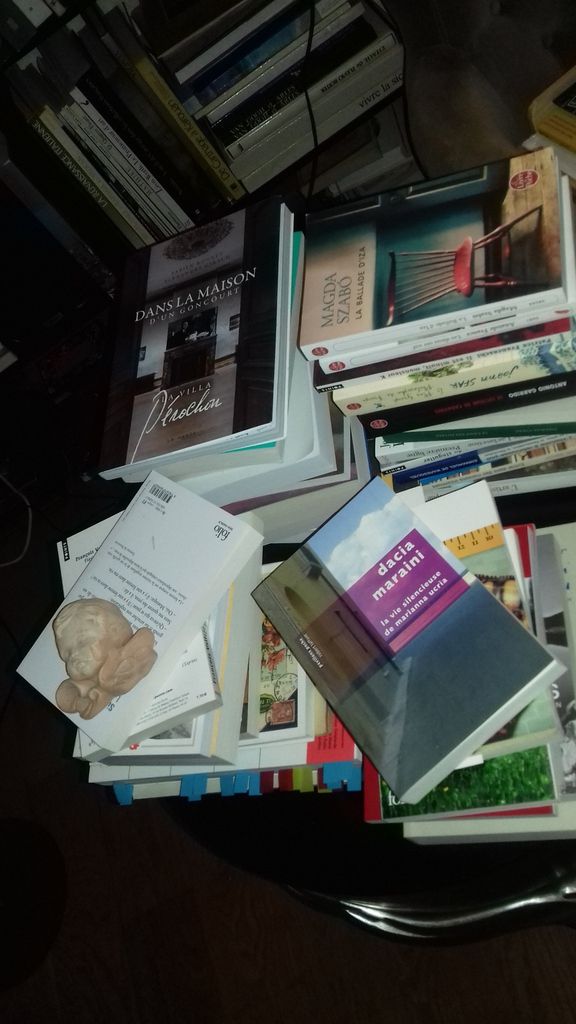
pour une belle année 2019
*petit message crypté : merci Denis pour m’avoir involontairement mais brillamment suggéré le titre, le reste était déjà écrit.
/image%2F2226645%2F20161227%2Fob_9506b1_brancusi.jpg)
