« l’impertinence polie »
l’eutrapélie de son vrai nom, lequel n’est pas seulement perdu mais aussi inconnu, sauf des hellénistes (toujours) distingués, des lecteurs d’Aristote, de Cicéron qui, tout en causant latin connaît un peu son grec, Saint Thomas d’Aquin un Père de l’Église qui s’autorise une glissade, Saint Paul pour ne manquer jamais un trait moralisateur ; sans l’avoir forcément appelée par son nom, l’eutrapélie fut l’objet de débats, de querelles, de développements allégoriques, d’essais, de parodies, de commentaires de commentaires et autres approches qui montrent, s’il en était encore besoin, qu’il vaut mieux avoir un terme pour punaiser une définition mais qu’en girandolant gracieusement autour par ajoutage, balayage, torpillage comme autant de nuançages, on distille par vaporisation sémasiologique des bouquets plus ou moins puissants de significations latentes à disperser en semailles fécondes ; ce que firent – entre autres – Ambrogio Calepino ou Robert Estienne, Érasme, Noël Du Fail pour les moins connus – encore que le calepin de Calepino nous soit familier … – Descartes, Pascal, Molière, mais surtout leurs commentateurs arc-boutés ou tordus mais penchés quoiqu’il en soit, au-dessus de mille équivalents d’un mot dont pourtant les supra nommés n’usent point. D’autres, au succès à peu près nul dans la grande braderie scolaire de la connaissance des Lettres, comme Guez de Balzac – dont la traduction de eύtrapelia par urbanité, francisation ultra fidèle de l’urbanitas cicéronienne nous laisse sur notre faim : elle ne tient pas bien compte du préfixe d’or – eu, eύ – qui, en grec, illumine doucement tout ce qui le suit par un poudroiement de bonté, de vertu ou de beauté – selon, une fois encore, la proximité des termes aux alentours, ce qui est, paradoxalement, vertigineux.
Cette approximation – ou ce floutage – dans les traductions françaises et latines de l’eutrapélie grecque a fini, évidemment, par la vider en partie voire totalement de son sens, puisque de « l’impertinence polie » – l’une de ses meilleures traductions chez Aristote – aux « propos grossiers, stupides ou scabreux » pauliniens, de l’idée d’un repos, d’une détente bienvenus pour l’âme chez Thomas d’Aquin à la toute simple bonne humeur, la vertu contenue dans les textes du Stagirite qui visent toujours la mesure médiane – l’eumétrie n’est-ce pas ? – cette vertu qui précède un enjouement adapté entre l’excès des bouffonneries et la sécheresse des rustreries*, a totalement disparu, en « faveur » de débats sur le rire, la parodie, la raillerie, l’hypocrisie, la bienséance – le quod decet – voire la convenance, où Molière est mis sur le gril avec Tartufe – mais répond dans une magnifique Préface trop passée aux oubliettes – ; Pascal mis à la question par les Jésuites qui ne semblent pas avoir saisi au plus fin l’enjeu de l’usage du rire chez ce janséniste avisé et ancien libertin, au moins nous offrent-ils un nouveau terme perdu sans avoir eu à le rechercher, la scurrilité ou la bassesse et le mauvais goût en matière de plaisanterie. La scurrilité est donc bien plus fréquente qu’on ne le croit puisqu’elle est contenue dans toute ironie mauvaise** – celle qui s’habille de bienséance et de beau langage pour condamner sans procès, sinon ad hominem, ce qui (le) dérange, ce qui s’appelle de l’abattage et de la bassesse. Reconnaissons à la scurrilité une plus-value d’élégance verbale.
Dès 1890, dans un article de « La Revue des Deux Mondes » intitulé sobrement Les Provinciales, un certain J. Bertrand faisait remarquer que le mot eutrapélie a(vait) disparu de nos dictionnaires. Se référant à celui de Trévoux (sous la direction de Jésuites) il fait valoir qu’il ne s’agit pas seulement d’amabilité, de politesse, de plaisanteries et de gaîté, il y faut trouver de la joie et du plaisir, faute de quoi cela ressemble fort à de l’hypocrisie, de la bouffonnerie. L’eutrapélie ne se peut, en conséquence, qu’entre gens d’esprit. Ajoutons, pour ne point troubler, qu’on peut être « gens d’esprit » sans pratiquer l’eutrapélie, les « gens d’esprit » ne sont pas exempts de quelques défauts, dont celui d’être dévorés du désir d'être facétieux à tout prix – y compris celui de la méchanceté. (formule du R.P Garasse, un des correspondants de Descartes). Tous ont lu Aristote dont ils « adaptent » l’Éthique à Nicomaque aux temps actuels et de laquelle ils reprennent les traits de l’homme noble par l’esprit, la conversation, l’invention d’une « douceur » dans la fréquentation de ses semblables qui n’est pas loin de ressembler à une sorte de bonne humeur d’honneur. Il y a de l’eutrapélie dans, par exemple, les Lettres à la princesse Elisabeth de Descartes et chez tous ceux qui en appellent – on pense à Gassendi – à la noblesse de l’esprit laquelle s’agrandit et se répand par capillarité entre gens vertueux, pourvu qu’elle ne soit pas posture mais principe de bonheur et de joie, le contraire — redisons-le fermement, c’est une exigence omniprésente — le contraire de l’ironie basse et vulgaire.
Dans L’Ethique à Nicomaque – II, 7 ; IV, 11 ; IV, 14 – Aristote a formulé à ce point l’essentiel, que la tradition chrétienne qui lui succédera aussi et d’abord dans l’exégétique des Pères de l’Eglise – Saint Jérôme, Saint Augustin, pour les plus fréquentés – n’a jamais eu à en corriger les principes si bien adaptés aux vertus chrétiennes. Loin d’elles – en des siècles plus laïcs ou des raisonnements athéistes – Aristote ne vieillit pas plus : cette disposition particulière est remarquable en ce qu’elle touche celui à qui elle s’adresse. Cela s’appelle le tact qui est d’un esprit libre, c’est-à-dire non porté par son intérêt privé à outrager l’autre. — la raillerie constitue une sorte d’outrage, ibidem 1128, a. Aristote ne manque pas de relever l’inconséquence qu’il y a à s’adonner à la bouffonnerie sans ménager les autres — tenant des propos que ne tiendrait jamais l’homme de bon ton, (et) qui ne voudrait même pas écouter certains d’entre eux, ibidem 1128 b — Il a fallu chercher un peu, mais dans l’Ethique à Eudème, le terme grec d’eutrapelia apparaît en III 7, 1234 a, traduit dans l’édition saisie au vol, par l’enjouement. Capacité de qui peut se situer à mi-chemin – la médiété si importante chez le Philosophe – entre l’homme grossier et l’homme froid à quoi je vais ajouter une petite pincée de mon sel et risquer de dire que les deux se confondent. Si l’on est assez grossier pour plaisanter aux dépends d’autrui on est donc – ergo, répondit l’écho – dépourvu de toute chaleur humaine. La médiété aristotélicienne désigne qui est capable d’inventer des plaisanteries dont un bon juge puisse se réjouir (l’enjouement) même si elles s’appliquent à lui-même. D’aucuns diraient, ont dit, disent : ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse, ou entendre ou lire ! Manier « l’impertinence polie » ne va pas de soi (l’expression est encore d’Aristote, in Rhétorique II, 12, xvi,) on y perçoit une quasi contradiction, il faudrait n’y voir qu’un ajustement mesuré (médiété) par l’évitement de l’hypocrisie – un terme trop « moderne » pour Aristote, mais pas pour Bossuet : « N’y a-t-il pas des hypocrites d’honneurs, des hypocrites d’amitié, des hypocrites de probité et de bonne foi », ceux-là n’ont de saintes maximes que pour eux-mêmes …
Cette politesse du cœur, on la doit à ses amis qui vous la doivent en retour. Y manquer – au nom d’une prétendue sincérité qui obligerait, par une nécessité de quelle nature ? à être blessant, au nom justement de l’amitié ! – en est l’exact contraire et montre de manière éclatante qu’il n’y avait que postures. Descartes pratiquait l’eutrapélie dans ses conversations (correspondances) privées et/ou savantes. La joie – l’enjouement – en sont la marque et la conséquence, ses Lettres à Chanut, remarquables à cet égard : Une longue fréquentation n’est pas nécessaire pour lier d’étroites amitiés, lorsqu’elles sont fondées sur la vertu. Il faudrait, hélas ! être bien plus vertueux que nous ne le sommes pour, comme lui, élever si haut notre esprit, qu’il ne pourrait s’abaisser à une offense reçue. Face à Christine de Suède qui, c’est le moins qu’on puisse dire, ne pratiquait et ne pratiquera pas l’eutrapélie envers lui, la déception de Descartes sera infinie, lui, incapable de dérision ou moquerie (cette) espèce de joie mêlée de haine … Tout honnête homme doit faire paraître la gaieté de son humeur qui est, avec la tranquillité de son âme, les marques de sa vertu car un esprit agile, sait donner une apparence agréable aux choses dont il se moque. Bien que le mot eutrapélie n’apparaisse pas dans le Traité des passions – peut-être même dans toute l’œuvre de Descartes, il faudrait vérifier – l’essentiel y est. Qui la pratique est plus vertueux, plus heureux, plus joyeux ; qui use de railleries d’autant plus immodestes qu’elles se prétendent justes et nécessaires, doit être profondément insatisfait et jaloux.
* ou rusticités si l’on voulait donner un écho à l’urbanité ci-dessus insatisfaisante. ** ibidem, Archives, de l’ironie, 3 février 2024
Loup y'es-tu ?
Le loup, solitaire, sauvage, méprisé autant qu’il se peut par les fascinations ambivalentes qu’il suscite, induisant de nouvelles détestations dues cette fois à ces propagations irrationnelles. Ainsi s’élabore la dimension mythique de toute réputation : il se peut qu’elle repose sur des fondements instables, on n’ose dire inexistants ce serait en annuler l’exposé de facto. Solitaire qui avance en meute, le loup presque toujours représenté en sa fourrure noire, a le museau fin, l’œil brillant et l’oreille aux aguets, sa morsure est puissante, ses attaques redoutables. On oublie dans ce concentré de poncifs pour faire peur aux enfants et aux niais – ceux qui n’ont pas les moyens de corriger les croyances dont on les a nourris – qu’il a pour ennemi principal sa propre méfiance envers les hommes, ce qui le protégerait, si les légendes qui le précèdent et lui survivent ne l’avaient emporté depuis toujours, un principe de précaution inutile vs l’intensité d'un principe d’égarement ; une sorte de misanthropie si l’on ne craignait l’usage d’un anthropomorphisme de mauvais aloi quoique présent depuis les récits fondateurs uchroniques et utopiques – ni temps ni espace situables – où les dieux, les hommes et les bêtes sont à ce point indistinguables qu’en leurs métamorphoses infinies toute mémoire est devenue incontrôlable.
Contrairement aux vestiges que recèlent encore quelques coins reculés de nos souvenirs, le loup n’est ni absent ni d’apparition tardive dans les histoires brouillées qui nous tiennent lieu d’origines fabuleuses. Zeus qui préside à tout, n’était pas le premier venu – stricto sensu – il lui fallut batailler sec pour se hisser, seul, en haut de l’Olympe, foudroyer les Géants et les précipiter sur terre, les écraser sous les montagnes qu’ils avaient eux-mêmes entassées. Zeus en fut bien mal récompensé, des Géants le sang versé, il fit naître des humains violents et cruels, jaloux et orgueilleux, contre lesquels il lui fallut aussi et encore se mesurer. Mais il était Zeus, prêt à toutes les manœuvres, par la force ou la ruse, ou les deux.
Les mythographes rapportent opportunément l’affaire Lycaon, le tyran d’Arcadie qui osa – par moquerie, outrage, démesure tout ensemble – narguer le dieu en lui offrant à manger de la chair humaine lors d’un banquet*, pour, dit-on, éprouver la vérité de celui qui se prétendait divin sous des apparences humaines**. Les récits, plus ou moins explicites c’est-à-dire fleuris de détails macabres ou réduits à leur plus simple expression selon les auteurs et surtout les péripéties qui menèrent ces textes jusqu’à nous, les récits s’accordent tous sur le point qui nous importe : ce cruel fut transformé en loup, ses vêtements en poils, ses bras en pattes, son visage farouche et ses yeux féroces ainsi le décrit Ovide, après de nombreux autres. L’histoire légendaire de l’un des premiers lycanthropes ou « hommes-loups », bien que sans âge, sans preuve, sans témoignage direct, irrigua de toutes les façons mais avec une puissance jamais démentie tous les contes, narrations, fables ultérieurs au point qu’à l’image construite par le mythe, s’est substitué un véritable archétype. Il traverse les siècles, les mouvements artistiques, les cauchemars des enfants, les chansons et contes populaires, les folklores ; il est métaphore, allégorie, symbole … Pausanias, Théophraste, Ovide, Pline l’Ancien, Platon pour deux phrases, Saint-Augustin, le loup-garou est de tous les temps et de tous les modes, des contre-sens aussi : si « l’homme est un loup pour l’homme » selon Plaute repris par Hobbes, cela ne veut pas dire que l’agressivité ou la cruauté entre les hommes est un fonctionnement « normal » … mais ceci est une autre affaire. On apprend aussi qu’il occupe une place visible dans la culture populaire actuelle de la Louisiane, au point d’être devenu, depuis la fin du XXème siècle un « emblème de l’unicité de la culture francophone (…) dans une société qui est majoritairement anglophone », ce qui lui donnerait presque – voire plus pour certains – valeur d’emblème dans la revendication d’une « franco-louisianité » militante face à l’anglais. Enfin, parce que c’est certainement le plus prégnant bien que le plus éloigné de l’imaginaire collectif, les premiers romantiques, comme on les nomma, en firent leurs délices … et une autre histoire arriva,
celle d’une métamorphose inversée, quand le loup se fit homme ou plutôt quand son image fantasmée devint portrait, quand le loup-garou (qui dans les contes populaires est artefact au service d’une religiosité de crainte, de punition et de pacotille) le loup-garou de légende devint lycanthrope d’écriture ... C’est bien la première fois que l’homme-loup n’était pas dans les récits, les mots, la littérature, mais qu’il les écrivait. Bien que le pauvre jeune homme qui se recélait sous ce sobriquet, qu’il s’était donné au sortir de l’enfance […] et qu’aucun ne s(û)t jamais la cause de ce travestissement*** Pétrus Borel fut, une fois pour toutes et dit-il sans raison ni venant de lui ni venant d’ailleurs, Le Lycanthrope devenu. Il faut dire que ses questions qui n’en sont pas — (ce travestissement) le fit-il par nécessité ou par bizarrerie ? c’est ce qu’on ignore entièrement — obscurcissent plus qu’elles n’éclairent l’affaire : Champavert aurait été écrit par un certain Pétrus Borel, qui se serait tué ce printemps. C’est Pétrus Borel lui-même qui le dit, affirmant que son vrai nom était Champavert. Autant d’auto-usurpations d’identité qui se retournent sur elles-mêmes valaient bien le détour.
Ensuite Pétrus Borel, ou Champavert on ne sait pas, se décrit – commençant par sa barbe longue qu’il se félicite d’avoir gardée contre l’usage de l’époque, ainsi le fit Léonard de Vinci dit-il … un brin fier de s’être donné cette filiation, y compris celle de saint Bruno dont il affirme avoir beaucoup de l’aspect ; suivent une incroyable description et présentation d’un portrait aux antipodes d’un lycanthrope dont tout le monde attend qu’il soit sinon cruel, méchant, cynique – étymologie du chien, souvenons-nous – voire ogresque, du moins susceptible de l’être tant ses écrits le laissaient entrevoir. Feu Pétrus Champavert était bon, doux, affable, fier, opiniâtre, serviable, bienveillant ; son cœur aimant … d’un amour qui devenait haine s’il était blessé. Pour affiner le portrait de celui qui écrit que celui qui écrit est pourtant mort, il compare sa mélancolie et son air de souffrance – concessions romantiques à n’en point douter – à l’image d’un cerf lancé hors de son hallier. Tout le contraire autrement dit, non seulement d’un loup, mais d’un homme-loup, d’un loup-garou, d’un lycanthrope ou même d’un simple déguisement de loup qui se doit d’être effrayant.
Certes, son enfance fut de nature à n’en faire point un être aimable ; méprisant ses maîtres et les épuisant par ses questions incessantes, Pétrus Champavert portait avec orgueil le privilège d’avoir été exclu de tous les lieux d’enseignement, nonobstant sa passion pour le savoir et son insatiable appétence pour la grammaire, les idiomes, anciens ou modernes. On cherche en effet ce que la lycanthropie eut pu lui apporter, si loin de son idiosyncrisie native. Ainsi Pétrus Borel parlait-il de Champavert ou plutôt de l’auteur de Rhapsodies, par Pétrus Borel, (1831) mort un an auparavant – texte daté de janvier 1824 ! – tandis que Le Lycanthrope mourut « réellement » le 17 juillet 1859, en Algérie****
Dans l’Anthologie de l’humour noir — mais à propos de Borel, il faut surtout lire l’article paru dans Les Nouvelles littéraires le 10 novembre 1923 —. André Breton dit de Champavert que ce livre est sans équivalent, mystification lugubre, plaisanterie d’une terrible imagination ce qui signifie vêtir d’une double apparence et peut-être même d’une apparence contradictoire – quand lugubre côtoie plaisanterie – donner une doublure dans tous les cas, sans savoir qui double quoi dans cette vêture ou cette couture d’un texte griffé par la patte d’un homme sous une peau de bête. Ces égratignures furent remarquées de tous, mais louées par les plus grands. Il nous plaît de retenir pour finir qu’en épigraphe de la cinquième « Ariette oubliée », Verlaine cite un vers des Rhapsodies dans ses Romances sans paroles (1872) : « Son joyeux, importun d’un clavecin sonore » ****** mais surtout, rapprochant Borel et Rimbaud (oserai-je dire que cette tentation est immense sur quelques points …) il écrivit au dernier en août 1871 : « J’ai quelques relents de votre lycanthropie ». Plus personne ne parlait de Pétrus mort et bien mort depuis 12 ans, mais, certainement quelques-uns le lisaient encore.
*une pratique fort prisée de nos illustres et mythologiques ancêtres. Cf l’histoire de Péplos qui commence aussi par un cannibalisme : archives – Janvier 2024 – Un os au fond de la mer
** les versions sont si nombreuses et diverses qu’il est impossible d’en donner les détails. Seule est commune la transformation de celui dont le nom disait déjà tout — Λυκάων, loup — et contenait ainsi son destin.
*** Pétrus Borel, Notice sur Champavert, in Œuvres poétiques et romanesques, Édition du Sandre p. 99.
**** cf (entre autres) ibidem : Une pensée fugace pour le Lycanthrope – Archives 9 juillet 2021.
****** cité dans l’excellentissime travail accompli par Aurélia Cervoni in Pétrus Borel – Sorbonne Université Presses – 2020.
La force des traces
L’Italie ne suffit pas, il faut naître en Sicile et tout près de Palerme, à Bagheria, petite ville côtière assez peu remarquable, sinon par cette Villa des monstres devenue curiosité pour touristes appâtés par ce surnom prometteur de frissons. Villa Palagonia ou Villa dei Mostri en raison des soixante-deux statues — mais six cents à sa construction — de nos jours rongées et noircies par le sable et le sel venus de la mer en face, qui ornent son mur d’enceinte dont les portails et arcs voluptueux aussi l’allée principale, ne sont plus dans la configuration du siècle où ils furent élaborés ; on dit l’ensemble baroque sicilien, adjectif d’importance qui démarque par sa tardivité, on lui préfère haut-baroque ; et ses sculptures que l’on dit grotesques* quasiment deux siècles après que Montaigne employa ce terme pour nommer les décors alambiqués déjà venus d’Italie, essentiellement des dessins et gravures. Venir au monde sur ce lopin de terre d’extravagances, de folies – y compris au sens architectural – et d’exceptions remarquables a fixé plus d’un destin. Renato Guttuso y naquit le lendemain de Noël 1911.
On ne rencontre pas par hasard ce mal connu de la peinture moderne, sinon au sens qu’André Breton donne, dans les années 30, au hasard objectif : la présence imprévue de circonstances ou de faits telle qu’ils deviennent des coïncidences liées par la nécessité de leur coprésence, nonobstant la carence de toute logique rationnelle.
Voyez plutôt : que Pieter Aertsen, Hollandais du début du xvi-ème siècle (me) menât à Guttuso, Sicilien du début du xx-ème, se fit en une étincelle, une sorte de « mais bon sang, mais c’est bien sûr ! » ce que d’aucuns appellent tout simplement une « évidence ».
Voyez surtout :
/image%2F2226645%2F20240411%2Fob_2a1af1_pieter-aertsen.jpg)
Aersten -1551- Étal de viande avec la Sainte Famille faisant l’aumône durant la Fuite en Égypte, huile sur bois, 115.6 x 168.9 cm - détail
/image%2F2226645%2F20240411%2Fob_cd31e7_vucciria-8-part5.jpg)
Guttuso – Vucciria 1974 – détail - [nom tout droit venu et déformé depuis le français boucherie parlé par les Normands passés par là au 12ème siècle n’est-ce pas ? – est une œuvre tardive à l’inverse de la Crocifissione, 1942, exceptionnelle et moins connue qu’on peut voir à la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Rome, i.e la somptueuse Villa Borghese.]
/image%2F2226645%2F20240411%2Fob_373d75_vuccheria.jpg)
Photographie personnelle
Plus de trente ans séparent Vucciria de La Crocifissione, (1941, huile sur toile )
/image%2F2226645%2F20240411%2Fob_313860_guttuso-la-crosifissione.jpg)
surnommée le « Guernica de l’art italien », on comprend pourquoi, découvrant les études de Guttuso d’après la Crucifixion de Picasso, œuvre de 1930 a) ; l’époque, justement, percluse de censure fasciste, exposait natures et paysages comme autant de sujets volontairement les plus éloignés de tout engagement politique. La Crocifissione, fit évidemment scandale, bien qu’elle fût la commande privée d’un collectionneur génois ** ; et si elle figure de manière officielle à l’exposition du IV Premio di Bergamo de 1942 où elle obtint le second prix du jury, c’est parce que son commanditaire la refusa et qu’elle fut rachetée par un autre collectionneur et peintre qui en comprit toute la puissance, loin des anathèmes qui pleuvaient de tous côtés, i.e en Italie, les omnipotentes autorités religieuses menaçant du pire tous ceux qui auraient l’audace d’aller la contempler. Celso Costantini, président de la Commission Pontificale pour l’Art Sacré, ne retenait ni sa colère ni ses mots : « bacchanale orgiastique de figures et de couleurs avec une femme nue qui tend les bras vers le Christ (…) ». Il fallait y voir, en effet une désacralisation délibérée d’une scène fondatrice de la chrétienté : que l’humanité christique mourût pour que sa divinité fût. Or le poing levé du Christ de Guttuso ne rappelait-il pas le très païen salut communiste ? La ville en ruines en arrière-plan ne venait-elle pas d’être bombardée ? Nous apprenons qu’en 1969 les autorités religieuses catholiques changeront d’avis pour voir en Guttuso « un narrateur biblique, d’une Bible en flammes, jamais finie comme l’est notre histoire. » Et le pape en exercice en 1973 – Paul vi – rencontrera Guttuso, un secrétaire plus inspiré, Mgr Pasquale Macchi, sera intervenu en ce sens. L’intention d’offrir la Crocifissione au Vatican ne fut pas retenue pour autant, mais Guttuso offrit trois œuvres dont le Triomphe de la Mort (1957) aux musées vaticanesques et sous l’effet probable d’une miséricorde aussi inattendue que cardinalesque, en 2004, Mgr Angelini touché par la grâce esthétique profane et la force de sa peinture, consacra une biographie à Guttuso dans laquelle on a pu lire que le « nu blanc-plâtre (de la Vierge ou de Marie-Madeleine ?) pouvait déranger seul un psychopathe. » Alléluia ! Guttuso ondoyé de reconnaissance par la famille même qui l’avait condamné aux gémonies plus d’un demi-siècle en amont. Cela n’est pas si rare.
Mais surtout, mais encore, mais par-dessus tout, le vrai, le meilleur Guttuso est resté un authentique Sicilien dit de lui Dominique Fernandez qui montre avec sa finesse distinguée habituelle que celui dont les œuvres se souviennent de Goya et de Géricault, n’a jamais oublié son sicilianisme splendide : ses couleurs – celle du marché de Palerme tel un bariolage enfantin de contraires ; son dérèglement inventif ; sa fureur abstraite ; tout est excessivement sicilien à l’image de la villa Palagonia, féroce. Un simple relevé de ses œuvres – Fuite de l’Etna ; Femmes qui pleurent ; Mineurs de soufre ; Pêche à l’espadon – fait un rappel constant de son île, non point l’hellénique et harmonique, mais la rouge où coule le cramoisi des chemises et le vermillon du sang.
Nous n’avons pas pour autant abandonné Pieter Aertsen. C’est bien à son tableau – Etal de viande avec la Sainte Famille faisant l'aumône durant la Fuite en Egypte - 1551 – que nous devons nos chemins de traverse. Aertsen, l’un des premiers semble-t-il, à avoir désacralisé la peinture – ou inversé les plans dit-on aussi pour atténuer le choc – en déplaçant des scènes des Écritures saintes que l’on aurait pu croire intouchables, à l’arrière-plan, le premier tout d’objets et/ou mets, viandes et fruits constitué prenant toute la place et franchissant ainsi et aussi un premier pas vers l’effacement, initie le glissement vers les mal nommées natures mortes, défuntes il est vrai de toute réminiscence explicite au religieux. Ici, l’exaltation picturale, sensible, de l’ici-bas chatoyant et bigarré l’emporte, la saturation par la vivacité des couleurs et l’amoncellement des objets domestiques, tandis qu’au fond, au loin, le sujet religieux est traité comme secondaire. Cela est tellement frappant – et ce ne sera pas son seul tableau – que la dimension profane mais sans profanation, fait « oublier » l’arrière-plan, le rend … invisible, invisible sa profondeur. Était-ce l’intention ? offrir l’immanence de la condition humaine aux regards par l’accumulation de nourritures bien terrestres et quotidiennes ? Aertsen peindra plus d’un marché en ce sens. Guttuso – qui vécut dans les ombres monstrueuses, extravagantes, incongrues, excessives de la Villa Palagonia ne l’oublions pas – fut-il précédé, suivi, accompagné par les couleurs, l’énergie, la compacité d’Aertsen avançant dans un invisible et impalpable vestigium pedis dans les travées du marché de Palerme, ignorant superbement les siècles et les espaces, comme le font toutes les traces, à l’opposé des preuves ?
*Sur la question : Philippe Morel, Les grotesques – Les figures de l’imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance. Flammarion – 1997 ; aussi, André Chastel : La grottesque – Editions du Promeneur – 1988
**Nous devons tous les détails inédits qui suivent, parfois restés dans des fonds privés, à la thèse de Rafaèle Martello : Paris 10 en cotutelle avec L’Università degli studi Roma Tre, soutenue à Rome en mars 2014 intitulée : “La présence artistique française au lendemain de la Seconde guerre mondiale en Italie : l’exemple de l’exposition “Pittura francese d’oggi : Rome octobre 1946.” manifestation restée jusque-là étrangement peu documentée, très peu citée, référencée, étudiée. Une partie de ce travail a consisté à reconstituer intégralement le catalogue.
Carlo Cornelio Suppo désire une crucifixion – 200 x 200 – à suspendre au-dessus de son lit. Question de Guttuso lui-même : Comment maintenir suspendue à ses rêves la scène d’un supplice ? Come farà a tenere sospesa sui suoi sonni la scena di un supplizio? Note personnelle du carnet de Guttuso, jamais publiée – datée d’octobre 1940 (in Guttuso, Capolavori dai Musei. Turin : Palazzo Brischerasio, Electa, 2005 p. 33)
a) Le tableau de Picasso, à la suite, trois études de Guttuso.
/image%2F2226645%2F20240411%2Fob_98b3ff_picasso-la-crucifixion.jpg)
Picasso La Crucifixion - 1930 -Huile sur contreplaqué -51 x 66 cm Paris, Musée Picasso
/image%2F2226645%2F20240411%2Fob_295299_guttuso-etude-d-apres-la-crucifixion.jpg)
Renato Guttuso - étude d’après La Crucifixion de Picasso -1938, (soit 4 ans avant sa propre Crucifixion.) - Encre sur papier - 31 x 34 cm - Rome, archives Guttuso
/image%2F2226645%2F20240411%2Fob_662010_guttuso-etude-pour-la-crocifissione.jpg)
Renato Guttuso - Étude pour La Crocifissione - 1940- encre sur papier - Rome, archives Guttuso
/image%2F2226645%2F20240411%2Fob_564904_guttuso-etude-pour-la-crocifissione.jpg)
Renato Guttuso - étude pour La Crocifissione - 1941 (soit à l’époque de l’achèvement de son tableau)encre sur papier - Rome, archives Guttuso.
l’enchantement du dire
ce nuage déplié au-dessus de ma tête
en charmant parapluie
*
sous l’air blanc des temps muets
et des mots invisibles
une poussière étrange et rude
danse
*
un léger silence
s’est posé en ma main
fermant le poing je le retiens
silence léger
en main
je tiens
silence
main
je
lâche
*
le diable se cache dans les nuages
à hauteur d’orages et de bonnets de nuit
*
je m’espère venant de loin
en tapinois et mille et une parasanges
tandis qu’au nonchaloir du monde
le temps laisse fluer une seconde à l’autre
*
à l’accotoir des mots
le sens menuise l’insondable
parfumoir des jours
et capiteux jasmins
enivrent mes miroirs
*
les loquèles des oiseaux
me font plus belles
les eaux du ciel
*
la nuit est un désert
drapé de ses néants
les chats-huants hurlant
*
pour faire contrevents
les coquelicots cousent
aux papillons
des ailes de papier froissé
Analecta, varia et autres spicilèges (5)
La synapse, figure de l’immense et fine configuration de notre cerveau par contacts entre neurones, nous en posséderions … un million de milliards !
*
Un terme dont on s’étonne que Freud ne s’en soit pas emparé, lui, si épris de l’ancienne langue grecque : l’hypogée, une construction souterraine.
*
« Les Illuminations de Rimbaud – Ce sont, soudainement apparues, aheurtées en des chocs aux répercussions radiantes, des images d’une beauté bestiale, énigmatique et glorieuse, suscitant du sang, des chairs, des fleurs, des cataclysmes, de lointaines civilisations d’un épique passé ou d’un avenir industriel. » Félix Fénéon in Le symboliste, 1886
*
Maurizio Pollini, décédé il y a peu dans son grand âge laisse en moi des souvenirs inclassables d’écoutes continuées de Chopin, alors que je trébuchais sur des textes non traduits – à l’époque – de Boèce, dont on ne connaissait que la Consolation … quand on connaissait Boèce. L’empreinte sonore laissée en soi par les très grands interprètes – je n’en ai pas plus que les dix doigts des deux mains sur le clavier qui me font cet effet – l’empreinte sonore, à jamais gravée — ce terme si conforme dont on usait à l’époque des disques. Maurizio Pollini, de longues mains si fines, des yeux de braise.
De Jankélévitch cette phrase qu’on croirait avoir été écrite pour lui, hommage : « Les grands maîtres du pianissimo, Fauré, Debussy et Albeniz se meuvent à la limite du bruit et du silence, dans la zone-frontière où ceux qui ont l’oreille fine perçoivent les sons infinitésimaux de la micro-musique ; aucune main n’est assez légère, assez impondérable pour obtenir du clavier les infra-sons et les ultra-sons que le divin Jerez d’Albeniz a captés : des doigts d’archange seraient encore trop lourds pour ce toucher immatériel, pour cet art d’effleurer, pour ce contact plus léger qu’une tangence. » Vladimir Jankélévitch – La musique et l’ineffable. 1983. Pour moi, Pollini avait ce toucher-là.
*
« Le ciel t’écrase sous sa semelle. »
J-M Maubert – in Décombres.
*
J’adore les intraduisibles italiens de la vie courante :
Fare il pianto greco : « faire la pleureuse » pourrait être un acceptable équivalent, à condition de lui adjoindre la touche d’exaspération qui nous saisit quand quelqu’un pleure ou plutôt pleurniche ou geint pour un oui ou pour un non, ce dont les Italiens n’hésitent pas à accuser les Grecs.
Arrampicarsi sugli specchi : ici, on entend ou on lit quelque chose qui a à voir avec la reptation, le fait de ramper … mais ramper le long de la paroi des miroirs, est mission impossible, on n’y arrive pas. L’expression est courante quand un quidam peine à justifier, expliquer, une position ou une opinion. Il baratine … il « rame », il s’enfonce ou il use de la langue de bois en français … bref, il ne s’en sort pas !
*
Relevé cette lumineuse et brève affirmation dans la préface de Marc Blanchet à un recueil de Franck Venaille : Un artiste est la somme de ses obsessions.
*
Entendu : « il promouvoit », conjugué comme voir … ! et lu : « le censureur »
Ciel ! de combien de gourdiflots ce monde est-il dorénavant constitué !
*
Éléonore — bientôt dix ans — me dit qu’elle aime le langage soutenu. Je réalise que ce terme – un chouchou de l’école élémentaire et du collège pour le distinguer du langage courant – est bien et mal adapté à la fois : qu’il doive être « soutenu » et qu’on ne le soutienne pas, est une évidence. Pour exemple que je ne lui demandais pas, elle me dit opprobre (orthographe ? oui, c’est bien, deux « p ») qu’elle avait lu – et retenu – récemment.
Quand, dans un élan poétique propre à cet âge mais en voie d’extinction, elle écrit que « la nuit tombe comme le vice » je m’inquiète, m’étonne et questionne : — « c’est dans un poème de Victor Hugo mais je ne sais plus lequel » — on lui pardonne. Pour ne pas être en reste – il faut son honneur garder – je lui dis qu’elle rencontrera toujours Victor Hugo à l’école, devancé par La Fontaine – tous deux chouchous des profs de français – en revanche, pas du tout Gaston Miron, dont je lui lis quelques poèmes à haute voix : Gaston et moi faisons un tabac !
*
… lequel La Fontaine aurait affirmé que le village de Richelieu est « le plus beau de France ». En Indre-et-Loire pays de vallons et de poètes.
*
Retrouvé chez Pétrus Borel, le nonchaloir dont je parlai récemment : « Dans toute sa personne régnait un nonchaloir, qui contrastait avec son maintien énergique. » (in Champavert, 1833)
Le même, pour dire qu’en avril le temps est incertain, invente tout simplement l’adjectif avrilleux.
*
« Faire route en solitaire fait partie de la condition du philosophe » — Nietzsche
*
« J’appellerai image cette impression de réalité enfin pleinement incarnée qui nous vient paradoxalement de mots détournés de l’incarnation. » Yves Bonnefoy - Lieux et destins de l’image, Paris, Le Seuil, 1999, p. 26.
*
Dans un texte « anticonformiste » – qui balaie les clichés et poncifs les plus courants – consacré à Rimbaud, cette citation extraite d’une lettre à Ernest Delahaye, mai 1873 : « … la contemplostate de la Nature m’absorculant tout entier. Je suis à toi, ô Nature, ô ma mère ! » ou la rencontre de la pure et géniale créativité sémantique avec le Jean-Jacques des Rêveries … à 19 ans.
Félix Fénéon, cf. supra –In Le symboliste, 1886 – le dit autrement : Rimbaud à peine âgé de vingt ans atteignait sa vieillesse littéraire.
*
Et dire que des milliards de soleils crépitent dans l’univers !
*
Nous n’employons quasi plus le terme pensum, lui substituant corvée voire punition – ce dernier n’étant déjà plus exact, car le pensum était le nom donné dans l’antiquité latine tardive, au poids de laine qu’une dame se devait de filer dans la journée pour satisfaire à l’une des obligations domestiques – et phallocrates dit l’auteur du livre précieux où j’ai trouvé cela – de l’époque.
*
René Char : « Un poète doit laisser des traces de son passage, non de preuves. Seules les traces font rêver ».
*
« Et je trouve en somme bien plus supportable d’être toujours seul que de ne jamais pouvoir l’être. » Montaigne – j’ai quelques noms pour souscrire à cette évidence …
*
« Lire est une expérience qui transforme de fond en comble ceux qui vouent leur âme à la lecture. Il faut serrer les vrais livres dans un coin car toujours les vrais livres sont contraires aux mœurs collectives. » - Pascal Quignard – La barque silencieuse.
Ce qui contredit les tropismes grégaires contemporains qui contaminent aussi la lecture, sommée – par injonctions insupportables et libraires – de faire l’objet de partages, de clubs, de communautés, de cercles… Lire n’est pas une occupation, un passe-temps, un loisir ... Quignard écrit – deux fois – les vrais livres. Voilà, tout est là. Toute lecture est solitude sociale. (ibid.)
*
d’ailleurs il faudrait voir à ne pas confondre, livre et littérature. Surtout en librairies, à la radio-télévision, dans les journaux et même à l’école. Bref : toute littérature est un/en/ livre – et non en écran – tout livre ou écran n’est pas littérature. Élémentaire non ?
*
« Respirare, ou le temps long des choses à leurs mots »
In Ce beau silence de flocons et de plumes
*
« Le silence est comme un bloc de glace que la parole fait fondre. » G.Perros in Papiers collés II – Notes – p. 137, pas toujours d’égale pertinence, mais là, il faut reconnaître qu’il n’y a rien à ajouter. (j’aurais peut-être supprimé « comme » toujours de trop, mais l’image est parfaite.)
*
« Héraclès ne saura jamais à quoi servent vraiment ses travaux » Roberto Calasso in Les Noces de Cadmos et Harmonie.
*
La catabase est un motif récurrent des épopées grecques : la descente du héros dans le monde souterrain des Enfers. Son complément et exact opposé, l’anabase, (« en haut » et « βαίνω » marcher : remontée) est d’usage plus étendu puisqu’elle représente autant une ascension spirituelle – y compris imaginaire – que rituelle en vue d’un lieu paradisiaque et céleste, différant selon les croyances. L’anabase a une dimension initiatique et/ou cathartique, mais désigne aussi en musique grecque antique une mélodie ascendante.
*
On disait, encore au début du siècle passé, d’une personne sans autorité, molle, qu’elle est un soliveau ; terme qui s’ajoute à la longue liste des mots disparus. N’empêche, il faut parfois se méfier des soliveaux, ils ont en effet des apparences de nonchaloir, mais – telle l’eau qui dort – se garder de trop de confiance, leur irascibilité rentrée peut se révéler à l’occasion du moindre ciron qui viendrait titiller leur placidité fragile : capables de sortir les griffes et de mordre à contre-temps et hors de proportion.
Quasimodo
en quelque sorte ou presque de la même façon, « quasi modo » réservé aux retardataires des fêtes pascales auxquels on concoctait une cérémonie de substitution le dimanche suivant … à une époque où la ponctualité se réglait avec le soleil le jour, les étoiles et la lune la nuit, aussi les cloches des églises, non qu’elles sonnassent les heures fixes les demies et les quarts exactement, mais le début et la fin des messes et autres rogations qui se pouvaient ouïr de loin. Encore fallait-il qu’il n’y eût point trop de nuages, de vents ou de pluies, soit pour entendre les carillons, soit pour voir les astres. Le quasimodo était un lot de consolation pour les clampins, les rossards, tout simplement les paresseux. Les bontés ecclésiastiques et canoniques sont infinies et pénétrables pour entrer aux royaumes des bienheureux par tous moyens disponibles. On pourrait croire que je raille ou plaisante, avec les mots j’avoue que oui.
Il y a quelques temps encore, les jours de la semaine menant à Pâques étaient nommés pascals, ce qui arrachait un peu mon oreille inhabituée à double titre à ce pluriel indélicat. Certes, quelques mots en al en français admettent un simple « s » pour se multiplier — et la routine évite l’erreur bien mieux parfois que l’analyse — autant des festivals, des bals ou des chacals ne font pas dissonance autant finals et pascals se perçoivent moins bien, pour ne rien dire de ceux – moins d’une poignée quand même – qui s’autorisent les deux, je retiens particulièrement val – vals ou vaux – pour avoir vu écrit, oui, oui, par « monts et par veaux » et même par vos … à ce niveau ce n’est plus sottise ni inscience, mais séisme, abîme, débâcle.
Les fêtes pascales, défaites aussi du vocabulaire et de l’orthographe, ont donné aux temps que l’on dit modernes leur quasimodo arrangé à la sauce chocolat. Autant l’entrée réjouissante par carême-prenant dans une période de restriction, à défaut de se comprendre absolument, peut se concéder, encore qu’il puisse paraître un tantinet tartuffe de se goinfrer avant de se serrer la ceinture, autant le virage quasi noëlien des bombances terrestres — certes, certes, il faut fêter la résurrection d’un corps dont l’âme est, elle, de facto, immatérielle et éternelle — par ceux qui ne ressusciteront pas de sitôt peut laisser quelques agnostiques sur le flanc, à qui elles paraissent tant loin des agapes pieuses des premiers disciples christiques ; de même la sortie fracassante de ladite période qui dure environ le temps d’un déluge biblique, sous forme de petits lapins qui pondent des œufs dans les fossés et de poulettes en papier mâché remplies de mauvais sucre, a perdu son réjouissant accent latin de sacristie au profit du bip libérateur d’une carte bancaire (possiblement bleue mais pas forcément) et dite « sans contact » alors qu’on la tient bien en main …
Du quasimodo pour session de rattrapage à l’adresse des oublieux paresseux des temps pascals anciens, au débordement jouisseur ignorant de ce qu’il fête, je me demande la réelle influence de mon prénom sur l’impossibilité d’opter pour l’un comme pour l’autre de ces excès.
Le petit peuple des limbes et des ronces.
Les écrivains savent-ils que, souvent et involontairement, leurs lecteurs bousculent l’ordre du temps ? qu’ils ne les lisent pas toujours dans l’ordre – la chronologie – qu’ils ont voulus pour eux ou que leur écriture a imposés ? qu’un livre, un livre qui (vous) marque, que vous allez garder en vous bien au-delà de toute mémoire pointilleuse, minutieuse ou méticuleuse, n’a pas toujours été (é)lu en raison de la loterie plus ou moins prédéterminée des contingences multiples qui nous menèrent à lui, dont une partie, une faible partie seulement, nous est connue ? et que le premier – pour soi – n’est pas toujours, parfois est rarement, le premier pour celui qui l’écrivit ? Ce petit chaos accidentel que le bibliophage impertinent introduit dans le cosmos d’un auteur qui trace son chemin, ledit auteur l’ignore le plus souvent … y pense-t-il ? même un peu ?
L’inactualité étant de mon usage, je pratique avec une obstination certaine la lecture anachronique — qui ne s’attarde ni aux annonces, ni ne tombe dans le battage et matraquage des publicités « littéraires » qui mettent en joie les revues et émissions du même nom et les libraires. Et puisqu’à toute règle il faut exception pour être crédible comme règle, j’excepte des parutions récentes, qui me sont indifférentes, celles qui – possiblement assez loin du barouf et des consensus médiocres – me sont de plume et-ou de savoirs décisifs ; je peux dire avoir eu ces derniers mois, quelques bonheurs inattaquables, de ceux qui me font lâcher (un peu) les philosophes auxquels je suis accrochée comme une moule à son rocher.
/image%2F2226645%2F20240327%2Fob_fbfc64_limbes.jpg)
Dans cette petite liste enchanteresse Jean-Michel Maubert apparaît ici pour la troisième fois non seulement sans avoir préconçu l’ordonnancement de ma lecture – quelle horreur ! – mais en ayant avancé à contre-courant, sans aucune volonté consciente, bien sûr : après Le Sacrifice du Géomètre – paru en décembre 2022 – Décombres – en novembre 2021* – je viens de refermer Limbes suivi de Ronces – novembre 2015. Voilà peut-être l’enchantement de cette remontée, rien n’y est étranger quelle que soit l’étrangeté : elle est semblable – en cela il y a une œuvre – elle ne l’est pas – en cela aussi. Une question me taraude à laquelle je ne pourrai jamais répondre : et si j’avais suivi le sens de l’écriture ?
Limbes et Ronces** réunis dans le même volume se ressemblent par l’essentiel – l’écrivant, je mesure la sottise de cette formule – aussi je précise, l’essentiel maubertien, lequel sera – au futur des œuvres à venir – était – au passé proche de mes lectures antérieures – revêtu de noir, maquillé de gris, couvert de rouille – y compris dans le lumineux Sacrifice du Géomètre - ; les enfants sauvages, en ce sens qu’ils vivent à l’abandon et entre eux aussi avec quelques adultes, sont difformés, malades, parfois déficients, toujours tendres ; les chevaux, rhinocéros, chiens font un bestiaire infirme et souffrant ; les convois ou déplacements processionnels, les rêves, les cauchemars ; les obsessionnelles mécaniques et machines zoomorphiques ou anthropomorphiques ; les lettres, les carnets, les écrits, les masques, béquilles, amputations et un rapport effroyablement insuffisant, voire nul, avec l’alimentation qui donne à la maigreur, à l’asarcie, une présence oxymorique ; les couloirs, labyrinthes, excavations, terrains abandonnés ou incertains ce que font entendre les deux mots « limbes » et « ronces », même si, sauf erreur de ma part, il faut avoir tourné cent quarante pages pour voir imprimé le premier. Tandis que le second est partout, ou presque.
Lucas est mort ce matin. La phrase si camusienne dans sa forme et en sa place — la première du livre — installe un décor, un « intérieur » un mouvement, presque un récit, mais la lectrice – instruite depuis deux livres déjà – comprend qu’ayant les clés de son appartement, celui qui parle, ou écrit, use(ra) de mots de passe, mieux, de révélations, ce qui veut dire de secrets, de mystères aussi, et qu’il nous faut entrer dans l’univers onirique de l’auteur, c’est-à-dire fantomatique et mythique, qui ne tient que par une logique sans le moindre rapport avec le monde réel dont pourtant il vient. Nous sommes en ville, les tours, le béton, les toits, les murs de briques, sont là pour nous en convaincre, seraient-ils labyrinthiques et d’une ville-machine.
Mona aussi n’est plus. Avec Lucas disparaît une enfance de tendresse réciproque, incomprise hors d’eux. Peut-être vivaient-ils – Lucas certainement, J-M Maubert le dit – dans une sorte de Purgatoire, mais les Limbes, ce non-lieu entre Enfer et Paradis, cet entre-deux entre néant et éternité, ce bout de rien réservé, dans la sémantique chrétienne qui n’a plus cours, aux Innocents au sens biblique, ceux qui n’ont pas péché, les Limbes leur vont mieux, bien mieux. Car enfin, quelle fut leur faute qu’un baptême de quel ordre eût pu racheter ?
Souvent dans le récit – on cherche en vain quel mot serait le meilleur ou le moins mauvais – les uns en rencontrent d’autres qu’ils suivent un temps et laissent sans pour autant les abandonner : tel homme maigre, qu’on croirait sur le point de se métamorphoser, tel employé d’une boucherie chevaline, qui anticipe ou joue prémonitoirement la scène nietzschéenne d’un cheval roué de coups ce qui le mène à l’internement et à être poursuivi dans ses rêves par d’incessantes images en fragments …
Toutes ces zones en friches dessinent autant des paysages « réels » bien qu’ils soient d’abandons, de misères, de maladies et de mort, qu’« irréels » parce que rêvés, souvenus, décrits ou écrits sur la ligne étroite et quasi invisible entre démence, déraison, spectres, mirages, chimères et précisions quasi narratives : incroyable plasticité de l’écriture de J-M Maubert nourrie d’un univers visionnaire infini où tout existe puisque les mots sont là « pour le dire » – quelque chose en moi pense. Qui a mis en moi cette pensée ? se demande étonnamment celui qui parle avec l’accent du Descartes des Méditations – à cette nuance près que les mots qui naissent pour le dire se décomposent en poussière. Ce monde, jonché lui aussi – cf Décombres – d’os, de crânes, de squelettes, d’animaux crevés, tanières, boues, bunkers, tunnels, est noir, tout noir, noir partout. Pas une seule page où le mot ne soit conjoint à un objet, une sensation, une impression, une vision, une idée et si ce n’est lui c’est le gris, la grisaille, les ombres, l’ardoise … Nous arpentons la nuit – nous qui sommes de la chair grise faite de nuit. Pas une page où il n’apparaisse, multiplié, surnuméraire, hanté, hantant jusques aux cendres elles-mêmes. Un monde où les portes n’ouvrent pas sur la lumière ou le jour mais sur des trouées d’ombre.
J’ai tout marqué à la pointe grise de mon crayon, il y faudrait des longueurs qui desserviraient le travail maniaque – au sens d’exclusif – de J-M Maubert. Une page m’a retenue – au sens de ralentie dans ma lecture, devenue plus paresseuse alors – par sa beauté simple ; est-ce parce j’y ai retrouvé le regard d’Actéon fasciné par Diane au bain ? une page qui ferait de chacun un parfait anagnoste, où Mona se baignait nue dans le lac.
Partout sont les ronces dans le second texte – et plus court – elles étaient déjà très présentes dans les limbes – insuffisamment hospitalières sous cet aspect, on n’en retient que l’innocence et la tendresse de ceux qui les hantaient. On sait, par la 4ème, que Ronces nous porte dans la vie – mais plutôt dans la tête de Georg Trakl et ses broussailles. On savait depuis Décombres aussi que là où il y a la sœur, Grete, il y a le poète. Ici, la parole est portée par l’aimée à la folie qui parle à et de son frère-amant-amour de sa vie. Celui dont la lecture – l’écriture ? – donnerait à penser qu’il l’aime plus follement qu’elle ne l’aime qui pourtant l’adore. Je ne sais. Et qu’importe au fond, J-M Maubert écrit avec passion tant les étranges et forts sentiments de ces deux-là que leurs hallucinations, leurs visions, leurs rêves aussi, bien sûr. Ici encore les eaux sont noires, le métal noirci, noirs les sillons, les arbres, noires les phrases, les racines, les bêtes et la rouille envahissante. Georg parcourt – du moins c’est une errance que J-M Maubert écrit pour nous – les champs de bataille de la guerre, celle qu’on dit la première mondiale. La biographie du poète confirme ces moments qui durent être au-delà du pensable tant les atrocités y culminèrent. Une page – là aussi inoubliable pour la raison inverse de celle que je nommerais d’ Actéon – tant le fracas des mots – importance de la ponctuation – en petites expressions courtes nous arrivent aux yeux et au cerveau par rafales : « l’inquiétude d’un pauvre chien – pluie lourde, tourbillons d’eau noire — lumière d’ardoise — opaque, dure, coupante — un amas de pierres gris anthracite sur le bord du chemin — la route — dans la poussière, les corps raidis d’un essaim de corneilles — ils jetèrent les cadavres dans une fosse boueuse (…) » ; la tête de cendre d’un cheval congelé dans la glace à peine le temps de nous étreindre, remplacée par celle d’un cheval amputé et d’une jeune femme, ensanglantée, à demi nue, comme crucifiée au milieu d’un tas de ronces … une contre-nativité – elle est entourée d’un âne et d’un bœuf – pour faire obstacle et offense à toute bonté divine dans ces champs de la mort.
Une autre page, magnifique, est mémorable – un récit de rêve, comme tant d’autres – parce qu’elle nous porte à nos propres mémoires de lectures et j’ai la conviction chevillée au cerveau qu’aucun grand texte n’existe seul, mais qu’il a – l’ignorerait-il et il l’ignore parfois – des béquilles au-delà de lui ; quand j’écris texte, je dis auteur ; ce peut être un tableau – la contre-nativité rassemble contre elles toutes les Nativités de la Renaissance – ce peut-être un récit qui a traversé les âges duquel ce texte est un bourgeon, un drageon, un rejeton, un scion, une greffe : nous sommes à Pompéi, au terrible matin où la ville a disparu sous la cendre, même la mer est grise, Pline ne reviendra pas, son corps dans la lave pour toujours. Georg fait de manière réminiscente et labyrinthique ce rêve où, étendu sur un rivage (…) le sable de la rive était gris (…) ce qui fut autrefois une peau d’homme n’était plus à présent qu’un mince voile de chair grisâtre (…) tu reposais sur un lit de galets noirs.
Texte où « les gueules cassées » nommées bouches fracassées par J-M Maubert nous percutent sans nous effrayer bien qu’elles soient effrayantes. — pouvoir absolu des mots justes — qui s’achève par l’inattendue découverte d’une petite hermine au dos marron, au poitrail et au ventre blanc, laquelle gisait dans un roncier mortel ; l’hermine – qu’il fallut achever, le mot est doublement juste, tant elle souffrait – peut-être pour préserver son innocence christique. N’avions-nous pas quelques pages auparavant touché du bout des mots et des vieilles mémoires qui nous constituent bien plus et mieux que nous ne le pensons, n’avions-nous pas frôlé cette présence et ce drame ?
*in Archives : 13 janvier 2024 : "tracer une ligne dont il faut penser la brisure serpentine" ; 28 février 2024 : "le désespoir d'être un mutant dans l'insomnie du monde ; ** Jean-Michel Maubert, Limbes suivi de Ronces, éditions Maurice Nadeau - 2015
Rimbaud, « vaste vates »
Vates, mot latin qui signifie le devin, le voyant - "Tu vates eris "-
Vaste, son anagramme exact, l’adjectif qui convient à ce piéton de la grande route, cet homme du vaste monde.
(rapprochement qui m’a frappée et que je n’ai pas pu ne pas faire, pas ? …)
/image%2F2226645%2F20240323%2Fob_52abbe_salon-pages-2023-nov.jpg)
Aux Sept considérations sidérantes au sujet d’Arthur Rimbaud d'Alain Borer* j’ajouterais — un peu imprudemment mais bien volontiers — une huitième qui engloberait et recouvrirait les autres alors qu’elle leur est, d’une certaine façon, extérieure : n’être sidéré par aucune en particulier ni toutes en général, c’est (encore) le cas, semble-t-il, de ceux qui ne voient ou n’ont vu en Rimbaud qu’un « immense poète » sans jamais le sortir du rang, l’exclure de toute norme, préférant l’inclure, certes, certes, en belle place, mais l’inclure, dans l’ensemble présentable d’une « histoire de la poésie ». A ceux-là ce texte s’adresse en tout premier lieu — c’est ma partialité avouée et avérée — ceux-là qui ont institutionnalisé Rimbaud et le trouve ainsi très bien servi.
Plus ma lecture avançait, plus j’étais convaincue que ces pages étaient à destination — non explicitement bien sûr mais si nécessairement — de ceux qui, pratiquant le métier d’enseigner, satisfont aux obligations académique, officielle et pédagogique, tout à rebours de ce que Littérature et Poésie, (aussi la Philosophie) doivent susciter : l’étincelle, l’éclair, le choc, la fulguration, l’illumination, l’ardeur pour toujours, jamais la froideur. Or il y a un Rimbaud bien rangé dans les cases et les casiers de la scolarité obligatoire desquels quelques poèmes – Le Dormeur du Val ou les Voyelles ? – rabâchés sans élan, affleureront parfois, encore y faudra-t-il trouver les occasions ; l’enseignant se sera efforcé, certains dans la douleur, d’autres dans la routine, de dire … quoi au juste, quoi e-x-a-c-t-e-m-e-n-t ? Rimbaud est sidérant, foudroyant, il nous laisse sur le flanc, allez donc rédiger quelque chose de construit avec ça ! C’est pourtant par cette collision enchantée que nous entrons dans un texte impeccablement précis et grisant, un texte superlatif et rigoureux, décisif et fervent.
Dans sa Critique de la faculté de Juger Kant ose et pose l’apparente antinomie que serait l’universalité d’un jugement subjectif si elle n’était résolue dans le seul cas du jugement esthétique. Les raisons particulières (au sens de motifs) que l’on a de juger (au sens d’affirmer en vérité) de la beauté d’une œuvre d’art ne pouvant être déterminées par quelque intérêt individuel, sauf à s’anéantir comme esthétiques, peuvent prétendre à une universalité (indépendante de toute connaissance intelligible i.e nouménale, laquelle reste inaccessible à notre raison limitée). Les sept considérations objectives déclinées par Alain Borer pour développer son argumentation – ce terme, bien trop désincarné, préférons lui expertise – sont, évidemment et à la fois imparables et saisissantes. Il faut tenir et maintenir le cap entre ferveur, ardeur et précisions, les unes singulièrement partagées par le plus grand nombre dont pourtant peu ont cette aisance et facilité à se mouvoir dans les autres : la raison, peut-être, pour laquelle Rimbaud est un sujet d’exclamations et un objet de renommée (de mythe et de légendes pour ne rien dire des erreurs) permanent. Ce texte évite ce redoutable grand écart comme piège, non en l’ignorant – l’envolée de Félix Fénéon en exergue en est le signe – mais, comme toujours, en le dépassant.
Aussi, pour échapper à la paraphrase de ces huit pages si construites et si enthousiastes que reste-t-il à ajouter, au fond ? – j’ai trouvé une parade qui me laisse fort quinaude, en m’inventant un petit exercice d’écriture selon ces consignes à moi et par moi concoctées : « reprenant les termes les plus importants du texte proposé, repliez-le en une phrase, 6 lignes et 60 mots au maximum, et moins de 400 caractères » : précoce artiste de la langue à la maturité quelque peu effrayante, inventant avant tous les formes modernes de la poésie et absolument seul dans cette expérience déterminante mais indifférent à sa valeur incommensurable au point de lui imposer un silence définitif, renoncement plutôt qu'abandon pour mieux inventer une Oeuvre- vie, une poévie, une liberté guidée seulement par elle-même.
Certes, ce n’est vraiment pas brillant, mais tout y est … les sept considérations sidérantes sont bien reprises ; tout est là mais Rimbaud lui n’est pas là – bien que rien dans cette formelle formulation — un stupide auto-contrat — ne lui soit défavorable. Il faut, quand il s’agit de Rimbaud, non seulement éviter tout ce que l’on croit savoir – le mythe et la légende – mais les chiffonner, froisser, jeter au panier et lire cet article ** : https://salon-pages.com/wp-content/uploads/2024/02/Alain-Borer-Sept-considerations-Rimbaud.pdf.
*Alain Borer – Sept considérations sidérantes au sujet d’Arthur Rimbaud – in le catalogue Page(s – novembre 2023 ; ** en « profiter » pour aller visiter le magnifique catalogue Page(s qui lui sert d’écrin.
L’avitalité ou la non-ardeur
Le nonchaloir est un nom qui se prend pour un verbe et aime nous tromper : nous balançons entre chaloir dont il ne reste plus que le trop oublié peu me chaut et choir qui nous fait trébucher, voir chuter en sa conjugaison où nous cherrons à tous les coups, car choirons – en relative logique de formation du futur en français – ne nous chaut point, bien qu’il soit parsemé ici et là ; et puis la chevillette cherra pour toujours, même si jamais personne en nos jeunes années ne nous expliqua ce cherra, qui tombait en nos comptines et nos tympans comme un cheveu (de sorcière) sur la soupe.
Nonchaloir – nom masculin – fut cependant décliné en des siècles si lointains à nos oreilles que nous ne les rattrapons plus et si notre intuition était juste, l’erreur aussi. En tant qu’infinitif, il fut en usage quasi fréquent entre le 12ème siècle finissant et disons le 17ème mais nous ne sommes pas super-experts, où l’on pouvait nonchaloir quelqu’un, le négliger, n’en point tenir compte, voire le mépriser – il devenait nonchalu – tandis que cette indifférence dévolue rendait nonchalant celui qui la pratiquait. Une signification qui s’est abîmée pour ne garder de nos jours qu’une certaine idée de l’indolence, ce terme cher à Saint-Evremond qui en usait en sa stricte étymologie* laquelle a disparu aussi dans les précipices de la négligence – çà, c’est pour la rime – disons charitablement, les effets des approximations successives ; être nonchalant pour avoir mis [un quidam] en nonchaloir est doublement inaudible** de nos jours : deux termes dont il est dit que, les trouvant en leurs significations et usages précis, il faut en relever la rareté i.e la préciosité – et ce n’est pas un compliment, les styles poétique et littéraire désignés premiers responsables et coupables ! dixeunt la plupart des dictionnaires.
Être nonchalant ou pratiquer le nonchaloir peut donc s’entendre de quelqu’un qui balancerait à s’engager par manque de zèle ou d’empressement, ce qui éclaire d’une meilleure lumière quelques comportements devenus courants dans les cercles privés et parfois publics où il vaut mieux se hâter lentement n’est-ce pas ? Vous encourez, il faut le savoir, si vous prenez ombrage de cette nonchalance-là, que vous vous gardez bien pourtant d’appeler par son nom, vous encourez reproches, réprobations et objections : on vous répondra « pondération » voire « sagesse » et, pourquoi pas, goût du « relativisme » ! Le nonchaloir du nonchalant moderne est un masque bien sûr, mais si bien appliqué qu’il fait enduit, ciment et vernis : en toute circonstance il y a quelque chose à dire pour rattraper quelque chose qu’il ne faut pas dire. Heureux les nonchalants du temps présent : le (faux) calme avec lequel ils font (faussement) entendre une pondération qui les protège est possiblement exemplaire en effet, sauf à n’en pas être dupe ce qui demande parfois une pratique certaine qu’on ne vous pardonnera pas. Blaise Pascal parlait de la nonchalance du salut en ce sens : l’indifférence, l’inintérêt, l’indétermination par le vide, l’adiaphorie, l’anesthésie du vivre.
Avoir toujours les Pensées près de soi.
* indolentia, absence de trouble(s) – ainsi un usage « politique » de ce terme lui est familier : « La Haye, dit-il, est le vrai pays de l’indolence », in Lettres, t. 1 – et de douleur(s). **pourrait-on éviter d’employer l’inaudible « inentendable », inaudible tant pour nos oreilles, fragiles, que pour avoir conquis les esprits paresseux ?
la déprise du monde
quand écrire a le goût de la neige
toute voix est plus douce qu’un ruban de velours
*
entre les doigts crochus
d’une tisserande
son destin a filé
*
les giboulées
ont dégravoyé la terre
l’en ont chaussée de semelles bourbeuses
*
jetées par les fenêtres mes pensées
tournoient dans le vent
se posent enfin
dans le chapeau du jardinier
qui poussait là
*
bateleur à mes tempes
il cogne aux parois de mon être
le bourdon
*
au creux de l’eau dentue
nocher avance ta barque
au-delà de tout espoir
*
les barquerolles du soir
suivent la ligne claire
d’une chanson triste au milieu de la foule
du clapot de l’eau l’écho
sous un pont sous un pont un pont un
ombres dorées reflets violets
où glisse et passe repasse et passe
la peau grise des apparences
*
à contre-jour du jour
les invivants fantômes
vêtus du satin rose des femmes nostalgiques
à contre-sens à contre-courant
montent les escaliers de bois
que le temps ronge en ricochant
*
deux ailes ensanglantées
noyées dans la lagune
et leurs plumes rouillées
aux châssis des pontons
si près des chevaux sombres d’Hadès
*
ombre poreuse emplit la fin du jour
sonate évanouie
dans un manoir obscur
au clair de lune
*
ciel enchiffonné
brouillonne en ses déluges
*
aux murs lisses et gris
le fil était-il rouge du sang du Minotaure ?
*
grains éclatés de grenade
en larmes incarnadines
brésillées dans la chaleur du soir
*
tournis infini
ritournelle éternelle
Démocrite en rit
Héraclite en pleure
faute de mieux
*
parfum doré et tiède de la bergamote
fragile cristal
captive souvenance
*
ne pas pleurer ne pas pleurer
pas sur le papier bleu
il devient pelure
inattendue broquille ronde et piquante d’un lundi matin
Je me souviens de ce mot, l’étonnant inconnu de beaucoup — smectique — lu en avril 2020 *, c’était hier, tous masqués sauf les yeux et confinés sauf les doigts, heureusement non gantés pour tourner les pages des livres en retard d’ouverture mis-de-côté-pour-plus-tard-quand-on-aura-le-temps, c’était le moment … encore fallait-il passer par le rite nouvellement entré dans les maisons privées du passage à savon des mains qui tiennent, prennent, soupèsent, attrapent, ouvrent, ferment, poussent, posent et reposent toutes choses niaisement. Nous apprenions l’obligation d’apprendre à nos mains à penser : il y avait là et partout peut-être bien, des milliards pour le moins des centaines de milliers d’animalcules possiblement mortels, indéniablement malfaisants et contagieux dont il fallait se prémunir. Le coup fut rude, très rude, mais comme tous les coups, il passa. Restèrent les états de nos âmes, différemment affectées, c’est le mot.
Surtout ne pas chercher à savoir — un comble pour la frappadingue de la comprenoire dont je suis — pourquoi ce mot dont la prononciation contredit l’onctuosité de l’objet qu’il vise, ni où smectique s’était logé pendant tout ce temps, ni pourquoi il refait une bulle un lundi matin de mars, le ciel presque bleu dans un silence quasi parfait ; sinon que l’esprit frappadingue frappe toujours et bien qu’une souvenance unguineuse ait la suavité d’un savon gras, elle ne glisse pas dans le néant mais se glisse dans une boucle d’instants détachée du présent urgent.
Tout à l’inverse du désastre des oursins qui obsède et bouscule le rare sentiment de vide de conscience qui parfois peut soutenir un léger équilibre au-dessus du naufrage du monde, des ruines de l’époque, de l’effondrement du temps. Trois mots, ou deux, deux mots qui, sans la moindre chance autre que les associations libres dudit esprit toujours un peu brissettien et flottant au gré de son auriculaire et auditif attachement aux sons des mots : des astres et des oursins … ou des oursons, hein ? où le petit de la Grande Ourse m’attire par ses cheveux (d’ange) vers le ciel admirer les espaces infiniment silencieux et mes souvenirs et se méfier de leurs piquants, autant d’aiguilles plantées aux nuées de la mémoire désastreuse du houx sain … Saint Jean-Pierre Brisset, au deuxième mois (dit Haha) du Calendrier de Pataphysique, la veille de la « Commémoration du cure-dent » dont l’un des mâchouilleurs les plus célèbres – après A. Allais bien sûr – est l’amiral – j’y entends admirable, ce dont je ne puis juger – Gaspard de Coligny, assassiné à la Saint-Barthélemy, qui pour beaucoup hélas ! est synonyme de saint glinglin, le saint de toutes les promesses non tenues, qui existe bel et bien puisqu’on le fête en faisant la Foire dans quelque(s) village(s) de France – retenons, pour revenir à nos bulles d’entrée, celle de Châlons-en-Champagne, qui, l’écrivant, fait mes yeux pétiller. Quand je pense qu’il y en a qui répondent qu’ils ne sont pas très bulles ! quand on les invite à partager la divine et toute laïque boisson mise à l’honneur et au goût des élégants par Saint-Évremond en son exil londonien ** !
Seraient-elles dévolues à la dimension smectique du monde, les heures fondent que l’on passe à écrire, comme le savon dans l’eau – « ça et vont » et « ça fond et vont » – dans l’eau, nous le savons bien, le moussaillon des eaux, des « Ô » qui spument pour nous sur l’écume des jours.
* archives, « Du savon, des dauphins, des confins » – 1er avril 2021 ; ** archives, « Le philosophe et le champagne » - 25 septembre 2017
de la pléonexie,
ça commence comme pléonasme et ce n’est pas pour rien. D’un préfixe grec qui festonne toutes les significations du « trop », du « plus », du « davantage », aussi du « de plus en plus », le pléonasme, par abandon de ses origines est devenu quasi synonyme de tautologie, ce qu’il n’est pas exactement. On devrait percevoir en tout pléonasme l’intention certaine d’en « rajouter » par insistance synonymique d’un ou plusieurs termes proches de celui qu’on surcharge. Cette intention ayant quasiment disparu, on retient aujourd’hui l’inutile répétition du même.
Au contraire, le mot pléonexie a gardé — parce que si peu servi qu’il ne s’est pas usé ni déformé — le poids de la surabondance et de l’excès. Il ressortit aux questions économiques, pécuniaires, financières quand il s’agit de les traiter du point de vue des richesses accumulées – ce qui, pour ces deux mots, fait véritablement pléonasme, dans l’intention et dans la signification. La pléonexie n’est pas tout à fait aussi vieille que le monde, elle est cependant très âgée ; la faveur et la ferveur avec laquelle une partie de l’humanité la reçoit désormais comme la fin de toute existence, s’oppose frontalement à l’autre qui la réfute ardemment, tandis qu’aux temps anciens de l’avènement balbutiant de l’usage public et commun de la rationalité, elle était très combattue. Sur ce point il faut relire Jean-Pierre Vernant 1 qui explique par le menu comment la pleonexia en grec représente le « désir d’avoir plus que les autres, plus que sa part, toute la part. ». Pour la contrer, on ne pense pas seulement à Diogène le Cynique – qui prêcha par l’exemple et tel Socrate ne griffa aucune tablette de son calame – on peut convoquer à peu près tout ce que l’antiquité comptait de penseurs, de sages, pour qui l’apprentissage de la vertu ne peut s’exercer que par un esprit libre de toute préoccupation matérielle. Paradoxalement, c’est dans la modicité que l’on y parvient, voire la pauvreté. Mieux vaut le dire autrement : l’accumulation des biens et des richesses, la thésaurisation de son argent, sa capitalisation au-delà de ses besoins propres et des nécessités vitales, sont condamnées par les Stoïciens, les Épicuriens, les Cyniques donc, Platon aussi au nom de l’éducation contre les faux semblants, Aristote … tous ceux qu’on appellera philosophes, alors qu’avant eux, les fondements du pouvoir politique selon la richesse, la ploutocratie, – ou même ce que prôna Solon à Athènes la proportionnalité qui, à y bien songer laisse de côté toujours les mêmes – était la règle, jusqu’à ce que Clisthène vint pour lequel ce n’est pas négliger la diversité des fortunes qu’exiger l’exacte isonomie de répartition du pouvoir entre chaque citoyen, compte non tenu de ses richesses personnelles.
La pléonexie, on l’aura compris, ce n’est pas la richesse mais la course effrénée pour toujours plus de richesses indépendamment des besoins qu’elles satisfont puisque l’ordre des raisons est alors inversé : ce n’est pas la détention de richesses la mesure des nécessités à acquérir, mais le désir — l’ennemi du besoin — d’acquérir de plus en plus de biens qui induit l’accumulation des richesses jusqu’à la richesse pour elle-même … On n’est donc pas étonné que de très nombreux textes de Marx – pétri d’éducation classique et semant du latin un peu partout – reprennent cette idée élémentaire, textes qu’on oublie de (re)lire de temps en temps. Ils sont pourtant clairs, faciles, indiscutables, reflétant non pas l’irrationalité d’une idéologie qui l’emporterait sur l’analyse – le reproche le plus courant – mais un raisonnement auquel il faudrait une dose de mauvaise foi pour en nier la rigueur, sauf à poser pour axiome de départ que toute richesse est toujours insuffisante et qu’il est de sa nature d’être cumulée. L’argent un concentré de contradiction (1857) ; De l’argent comme drogue (1857) ; « Tout est achetable » (1858) ; autant de titres extraits des Manuscrits qui – hors vocabulaire manifestement économique au sens moderne du terme – reprennent des propos qu’aucun philosophe antique n’aurait pu désavouer.
Contrairement à l’acception la plus courante, l’argent selon Marx est une pure abstraction. Là où tout un chacun – confondant le moyen et la fin – considère qu’étant le moyen d’acquérir des biens sous une forme toute matérielle, tangible, il serait contradictoire voire ridicule, d’affirmer qu’il n’est pas matériel lui-même ; c’est pourtant le cas, puisqu’il est « seulement » échangé contre différents biens et objets acquis par son moyen. Il est exactement parlant en circulation, c’est même la seule façon pour obtenir la jouissance individuelle indéfiniment reproduite dans ce processus (Marx dit toujours procès) que nous appelons de nos jours la consommation, oublieux de la proximité étymologique de ce terme avec consumation, consumer, calciner – l’argent brûle les doigts – dit-on parfois, jusqu’à devenir une fois acquis les biens convoités leur pur fantôme pour un moment donné, le mécanisme reprenant ad infinitum jusqu’à confondre la valeur avec la quantité. Posons un instant que le mécanisme s’arrête là, l’accumulation perd en valeur ce qu’elle ne fait pas croître qui, de facto, diminue. La dépendance – caractéristique de toute drogue — est installée en dehors de l’individu qui en est pourtant victime, l’argent comme une chose qui m’est tout à fait extérieure, me met en danger comme personne libre et autonome : je suis, tandis qu’il m’est extérieur, incapable de m’en séparer, c’est une contradiction majeure.
Pourtant individualisé comme moyen de possession singulière, l’argent est le souverain et le dieu du monde des marchandises. En 2007 Dany-Robert Dufour reprit l’esprit de cette expression marxienne pour titre d’un essai 2 passionnant, précis, cultivé, référencé, foisonnant 3 où l’on comprend que la trame essentielle de l’analyse des rapports de l’homme à l’argent donc à la marchandise ne s’est pas modifiée avec les siècles, sinon dans les objets acquis, devenus plus nombreux et complexes, valeurs quantitatives s’il en est. Dans la mesure où la relation de l’individu à l’argent est contingente – elle ne le représente pas dans son individualité – étonnamment elle le domine et l’asservit dans des jouissances jamais assouvies, c’est le propre de toute drogue. Cette frénésie d’enrichissement — cumulatif donc matériel — est, dit Marx, auri sacra fames, citant Virgile, elle relève de la pulsion. Ce qui explique que les Anciens – c’est toujours Marx qui parle – l’aient tant critiquée pour ne pas dire plus : représentant concret d’une abstraction, la richesse, l’argent qui génère avarice et frénésie s’oppose directement à l’idée même de communautés (humaines, pléonasme !) il est la possibilité même de leur déclin.
L’argent contient en lui la puissance de sa propre pléonexie, devenant la richesse en acte. Il est l’agent de l’aliénation résultant de son dessaisissement pour acquisition, n’étant que circulation et échange permanents, on comprend le cercle vicieux par lequel « tout est achetable », toute chose n’ayant, par l’argent, d’autre valeur que la pure jouissance individuelle, rien ne peut plus avoir de valeur autonome – ou absolue – Tout est sacrifié à la jouissance égoïste. L’aliénation de tout par l’argent est alors illimitée jusqu’à l’argent lui-même qui peut s’acheter, se payer, s’accumuler, se capitaliser, thésauriser, sans préjuger des moyens pour y parvenir, fraude et violence etc.
La pléonexie, phénomènes mécanique et psychique mêlés , est négation des res sacræ ou religiosæ à l’instar de toutes les autres (en latin dans le texte), elle s’auto-alimente, digère et reproduit, l’argent devenant en tant que tel sa propre destination et réalisation.
1)Notamment dans Les origines de la pensée grecque, mais pas seulement ; 2) Dany-Robert Dufour : Le divin Marché – Folio Essais – 3) Cf Archives- 25 janvier 2017 – « L’égo-grégarité est la nouvelle humanité ».
Sous le signe du Taureau
Un bucrane est composé de mufles qui ne sont pas les fleurs du muflier qu’on appelle aussi gueules-de-loup ou gueules-de-lion ; ces mufles-là ne sont pas non plus des goujats ou des pignoufs, ces derniers bénéficiant d’une épaisseur littéraire attestée*. Notre ci-devant mufle au contraire, est beau, silencieux, enguirlandé de feuilles et de fleurs, immobile et même statique pour nous mettre sur la voie — l’antique bien sûr — où il fait témoignage minéral de légendes et sacrifices anciens. Le bucrane dispose harmonieusement plusieurs mufles, des crânes de bœuf ou de taureau aux cornes élégantes sur des socles en pierre ornant des édifices ou leurs propylées, aussi des mausolées ; il raconte des fables que nous portons tous un peu en nous, dont nous savons des petits bouts, dont nous aimons croire qu’elles sont un peu vraies …
Zeus, on le sait, ne recule devant rien ni jamais. L’hésitation n’est pas de son usage — ce qui lui valut parfois quelques contrariétés. Mais plantons le décor : une plage suffit. C’est la scène primitive de tout ravissement et l’origine du monde.
Le sable devint ardent au soleil métallique, le ciel mordant, le taureau blanc qui, ayant déposé toute force devant tant de beauté se laissa caresser, chevaucher, flatter, puis entra dans l’eau entraînant la plus belle des belles : elle ignorait que le dieu fendait l’écume jusqu’à l’île lointaine pour mieux l’aimer.
A la demande de son père Agénor, Téléphassa sa mère, Cadmos, Thassos et Cilix ses frères, partirent à la recherche d’Europe, la princesse emportée par le puissant animal divin. De chagrin Téléphassa mourut, de honte d’avoir échoué ses fils ne revinrent pas, demeurés loin et pour toujours de leur terre phénicienne. Europe restait introuvable.
En Grèce où il débarqua, Cadmos s’en fut à Delphes interroger l’oracle qui lui prescrit de suivre la génisse errant à la porte du temple, ce qu’il fit jusqu’arriver à Thèbes avec ses compagnons.
Déjà Io son ancêtre, la thauropárthenos, elle aussi aimée de Zeus en dépit de la colérique Héra, fut transformée en génisse — de l’espèce bos taurus — pour que le tempétueux, une fois encore taureau devenu, puisse la mieux aimer elle aussi, au moins tant qu’Héra ne découvrit pas le stratagème qu’elle avait elle-même contribué à constituer.
Zeus n’est décidément jamais assagi. C’est encore lui qui envoie le grand taureau blanc dont Pasiphaé tombera follement amoureuse, donnant à Ariane et Phèdre un frère, Astérion, qui pour n’être pas fils de leur père, n’en est pas moins celui de leur mère. Une étonnante version – du Pseudo-Apollodore – rapporte la construction d’une artificieuse génisse de bois, d’autres disent « un géant mécanique inventé par Héphaïstos » – entendez-vous ici un cheval de Troie ? – dans lequel la reine se serait glissée pour approcher l’objet de son amour interdit. Quand il ne franchit pas l’espace incomblable des mondes marins et terrestres, le taureau se fait gigogne pour mieux entrer dans la légende, à moins qu’il ne descende directement du ciel étoilé – la constellation du Taureau – ou ne sorte des profondeurs marines comme Poséidon. Le taureau grec est partout, il est de tous les textes et dorénavant dans les bucranes où, telle Europe, toujours des enfants le tiennent par les cornes.
Une mosaïque romaine, peut-être du IIIème siècle avant notre ère, reprend ce geste avec délicatesse qu’Achille Tatius décrit ainsi : il fallait qu’elle fût assise de côté pour qu’en une seule main elle prît les cornes et d’une légère pression fît obéir le puissant animal — ainsi font les conducteurs de char en tenant les rênes — et de l’autre, lui caressait la croupe. Une longue et large écharpe gonflée par le vent volait depuis ses épaules jusqu’au-dessus de sa tête, telle la voile d’un bateau avançant sur la mer, Europe sur le taureau chevauchait les vagues.
*Rimbaud bien sûr, sans oublier Pétrus Borel pour l’apprenti cordonnier dit aussi, le gniaf.
« le désespoir d’être un mutant dans l’insomnie du monde. »
Par ces mots d’une infinie tristesse s’achève Décombres* de Jean-Michel Maubert un livre qui recueille trois textes — Bestiaire, Pénombres, Abattoir — écrits rampants dans la terre boueuse et le sang noir, modelés au plus près de visages fracassés, couverts de peaux déchirées et de corps blessés, poussés dans la rouille et le béton de paysages épais et lourds des souffrances de mille créatures pérégrines, effrayantes-effrayées, desquelles une terrifiante bonté ressue désespérément.
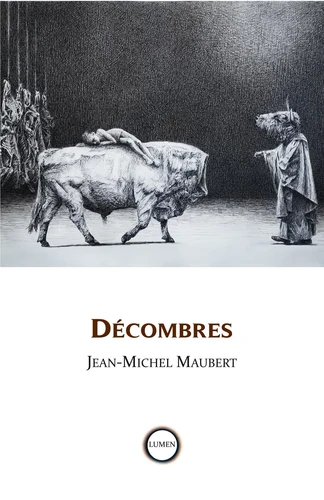
Je ne sais pas si l’on peut parler — et se faire comprendre — d’hyperbole négative pour tenter de qualifier la force tellurique de l’écriture de cette prose époustouflante dans ses mots, ses phrases, ses organisations mêlées, où le sens premier et sacré du mot texte se crée à chaque ligne et page dans un tissage de motifs filés en teintes et sonals modifiés dans l’invariable. Il n’y a alors de négatif que le sens photographique d’un révélateur, la puissance de faire advenir d’étranges beautés troubles, d’apocalyptiques paysages, d’hallucinantes créatures hallucinées, d’infinies bontés et souffrances jointes au milieu des gravats, gravois et ruines d’un monde dont on ne sait s’il est déjà passé – il y a quelques dates à ce calendrier infernal et quelques indices, dans Abattoir notamment – ou s’il va nous submerger bientôt. Loin d’être une négation inféconde, ce « négatif » retient pour mieux les lâcher, contient pour mieux les montrer, l’infinité des possibles humains, rien qu’humains, l’écho nietzschéen est volontaire bien sûr, à cet écart près que Jean-Michel Maubert humanise tout ce qui vit et respire, naît et meurt.
Décombres paraît un an environ avant Le sacrifice du géomètre et autres textes** ; le hasard objectif et heureux de ma lecture en ordre inverse de parution, fut, il me semble, un atout, une chance, pour entrer dans les impressionnantes visions de J-M Maubert. Ce monde qu’on dirait préhistorique et-ou légendaire, translaté dans une époque post-industrielle apocalyptique — Bestiaire — est, à bien des égards, celui du géomètre à venir ; les variations chromatiques des gris, noirs et anthracites comme autant de fils croisés d’une tapisserie onirique ; le labyrinthe comme leitmotiv architectural et image obsessionnelle ; la femme-machine aux accents lamettriens – on n’oublie pas que La Mettrie, le philosophe du 18ème siècle, était médecin, une figure et un personnage centraux dans le livre, notamment dans Abattoir – et d’anti-thaumaturges qui mutile(nt) des bêtes pour créer des animaux-machines dans le quartier des abattoirs qui était comme un labyrinthe ; les ailes, icariennes réellement, i.e nées avec l’enfant, mais icarien est aussi le nom qui désigne le monde du cirque, lequel avance et dépérit, sauf à avoir pu être cinématographié — Pénombres — ; les os, les crânes, les squelettes des morts ou des vifs, bancals, tordus, en miettes, les peaux ternes, toute d’opacité lunaire, les odeurs extérieures et internes, une puanteur d’égout dans la tête ; des agonies éternelles et des blessures inguérissables. Des rêves et encore des rêves sculpteurs de réalités sombres. Des textes, des lettres, des récits, des mémoires et autres cahiers — Abattoir — imbriqués les uns dans les autres, indescellables, autant d’écrits internes pour cimenter les mots qui retentissent d’un livre l’autre ; des Pénombres et métamorphoses illuminées de lumière noire – Kafka, Trakl, Tarr, immergés anonymes dans les images tourmentées, une chapelle de ténèbres – ou quand l’axolotl peut côtoyer Hegel, et l’image à peine floutée de Nietzsche ou plutôt diffractée en reprises déclinées de l’épisode vrai de son effondrement physique et psychique pour avoir protégé un cheval des coups de son maître cruel***, l’épisode biographique est suffisamment connu pour n’être pas nommé. J’ai voulu deviner aussi – ai-je bien fait ? – parmi plusieurs Rhinocéros dont un muni d’une béquille, celui de Dürer, pour être chercheuse et trouveuse obstinée d’indices, le burin du sculpteur apparaissant quelque lignes plus loin ; un porc-épic schopenhauerien ? peut-être même – mais ne suis-je pas saisie par une sorte d’auto-fertilité au contact de ces pages ? – peut-être même une Frida Kahlo imprécise dans ce bref portrait de femme, des yeux noirs intenses, un teint de craie étonnant —( était) blessée, une barre de métal lui était entrée dans une jambe.
Les animaux et les humains ont échangé leurs membres, leurs peaux, leurs visages, indistinctement. Ils sont mutilés, blessés, agonisants, inexistants aussi, soit pour être ce qu’il convient de nommer des morts-vivants, soit pour être conçus par la seule plume de l’écrivain, soit pour survivre sans fin ni faim aux conditions qui mènent depuis toujours à la mort assurée : l’exemplarité du Jeûneur, l’artiste de la faim, l’une des plus fortes assurément. J-M Maubert, qu’on ne s’y trompe pas, ne déroule pas le monde des lamentations, ces Décombres feraient-ils signaux pour les ruines et destructions passées et à venir, réelles ou imaginées. Il y a une joie sombre et antique qui nous ravit au sens le plus fort et ancien de ce terme, un rapt, non une délectation. Et notre âme – quels que soient les sens que l’on donne à ce mot, les philosophes ont des réserves en leurs besaces – en est toute chavirée.
L’âme est en vérité chose étrange sur terre dit Georg Trakl dans un de ses poèmes — vers commenté sur toutes ses facettes par Heidegger dans le chapitre qu’il consacre au poète, in Acheminement vers la parole — **** chose si étrange que les animaux n’en sont pas dépourvus : leur bonté pour les humains, et souffrance comme eux, si l’on voulait être plus que concis. Dans un autre poème, toujours cité par Heidegger : … Un visage animal/Saisi d’azur, devant l’azur sacré se fige. Et le philosophe de poursuivre évoquant la fixité du masque animal pour entrer dans le tacite. Dans Décombres et précisément Abattoir, le troisième et dernier texte, on sait, on apprend, on comprend, on lit que J-M Maubert reproduit, loin, près, l’itinéraire de Georg Trakl, où il opère sinon un renversement, au moins une inversion des masques : ils couvrent les visages humains, tandis que les animaux ont figure d’hommes — oh ! cette araignée qui sourit telle celle d’Odilon Redon — et inversion n’est ni contradiction ni négation. Dans ce monde à la Jérôme Bosch, où l’on croise un agneau-chat, un chien fumeur, une souris chanteuse, on côtoie les pires atrocités et les plus hautes bontés dans un partage inattendu et jamais définitif entre les mondes humain et animal. De Trakl, chez Maubert, on retrouve les traces transposées mais lisibles du charnier de la grande guerre – les horreurs auxquelles il dut – au sens d’obligation – prendre part comme assistant médical ; l’obsession pour la sœur – ici édulcorée tandis qu’elle fut réelle parce que réellement incestueuse pour le poète – la sœur qui, dans Pénombres, a écrit des poèmes géométriques ; aussi l’usage du terme pourriture et synonymes explicites, titre d’un poème, Verfall, parmi les plus célèbres de l’écrivain autrichien.
Ces boucles qui nouent les trois textes de Décombres entre eux et avec le Sacrifice du géomètre à venir en termes de date de publication, se font par le vocabulaire, le choix des mots, leur usage intensif ou rare, ce qui, dans les deux cas, les rend remarquables. L’un des plus visibles, pour une empédocléenne non repentie, est celui de fragment. Certes, mon œil sélectif est coupable, mais les fragments, comme mot, sont si présents qu’on ne peut pas ne pas les saisir pour toute image de l’écriture et du monde écrit, décrit de et par J-M Maubert. Et pour autant qu’on les rapporte – audace de la lectrice emportée par le texte – aux labyrinthes et masques de toutes espèces, les mondes maubertiens faits de mille morceaux dispersés et souffrants qu’il recoud, répare et panse par son écriture colossale, font un univers d’éblouissantes et sombres créatures portées par « le soleil noir de la mélancolie. »
* Editions de l'Abat-jour, Collection Lumen. **Éditions Sinope, novembre 2021** cf archives 13 Janvier 2024 « Tracer une ligne dont il faut penser la brisure serpentine » ; *** (Neal) Il s’était accroché au cou d’un cheval qu’un charretier battait à mort. On l’a emmené à l’hôpital. Depuis, il passe sa vie en institution. **** « la parole dans l’élément du poème ».
en entendant la pluie
et non en l’écoutant, tandis que je lisais, feuilletais, cherchais en moi et hors de moi des étais pour satisfaire l’écriture – le passage au sens – d’un texte dont le silence serait le motif, le dessin et le dessein tout ensemble ; *
écrire ce mot que mon oreille attrape en scie et lance, c’est déjà le rompre et le saisir comme vide sonore … intuition aussitôt démentie par l’explosion nerveuse des gouttes rebondissantes, même si le crépitement de l’averse ne semble pas avoir inversé mes sensations : il y a des bruits qui n’offusquent ni n’offensent un certain silence ; pour n’être pas antagonistes – ce qu’ils sont le plus souvent – les bruits doivent faire échec à tout vacarme et le silence au dénuement.
Je me souvins suffisamment pour l’aller chercher dans l’instant, d’un passage des Essais critiques IV**— intitulé Le bruissement de la langue, titre que j’avoisinai pour la première fois je crois bien à l’une de mes expressions fétiches retenues de Merleau-Ponty le silence bruissant de paroles — dans lequel Roland Barthes rapporte quand et comment il éprouva tout d’un coup au milieu d’une scène sonore s’il en est — des enfants lisant à haute voix en chinois, chacun pour soi mais tous ensemble des livres différents, ce bruissement de la langue dans la musique, le souffle, la tension, l’application, en un mot la jouissance, et confirmait ce que je savais : le silence n’est pas l’atonie, n’est pas l’apathie ni quelque somnolence gagnée sur l’extérieur. Barthes dit un peu plus haut dans le chapitre : bruire, c’est faire entendre l’évaporation même du bruit ce qu’en présence d’un double obstacle pourtant — méconnaissance du chinois lequel était de toute façon brouillé par la lecture simultanée de textes différents — on pourrait croire inaccessible. Ce bruissement de la langue n’est ni le contraire ni l’élimination du silence, mais sa possibilité.
Dans La barque silencieuse, Pascal Quignard rapporte que dans son dernier entretien public, Roland Barthes, peu avant qu’une camionnette funeste ne le renverse, s’inquiétait que le retrait devînt un défi véritable de nos jours. Le retrait, qui ne signifie pas solitude ou isolement, a bien quelque chose à voir – à entendre – avec le silence : pour se rendre invulnérable aux bruits du monde, il faut s’exercer — au sens de Montaigne — à ne pas les faire entrer en soi en dépit de leur présence, le contraire de ce que Quignard lui-même décrit dans les premières pages de Le vœu de silence quand il est vœu de se taire, dans quoi l’on peut être emmuré vivant. Dans une déclinaison moins mystique mais plus actuelle, on songe à qui ne quitterait jamais ses écouteurs emplis de musique — artifice qui devient dépendance — pour n’avoir pas à affronter son semblable comme homo loquens.
Il y a quelque chose d’apparenté à ce bruissement du silence dans la langue, dans la manière dont Jankélévitch décrit l’usage des mots par le philosophe : tourner et retourner (les mots) sous toutes leurs faces, dans l’espoir qu’une lueur en jaillira, les palper et ausculter leurs sonorités pour percevoir le secret de leur sens. Les assonances et résonances des mots n’ont-elles pas une vertu inspiratrice ? que seule la qualité d’un silence qui amuït tout rapport aux sons extérieurs plutôt qu’il ne les supprime – le clapotement d’une pluie qu’on entend bien qu’on ne l’écoute pas — rend possible. Pour le mélomane délicat et savant qu’était Jankélévitch, il y a dans le rapport aux mots que le philosophe se doit d’engager pour penser avec acuité et élégance, quelque chose de pianistique. Il s’agit d’explorer les résonances sémantiques, analyser leurs pouvoirs allusifs, leur puissance d’évocations, jusqu’à vérifier qu’il ne peut décidément aller outre. La phrase et la phrase musicale, ne se peuvent élaborer sans avoir imposé silence aux bruits. Les bruits, pas les sons. On s’étonne que nombre de lecteurs ou mélomanes prétendus aillent aux livres et à la musique sans se soumettre à cette terrible épreuve, la confrontation primordiale à ce silence-là. Née du silence, elle se replie dans le silence, telle est la réflexion du philosophe, l’écriture du poète, la musique du compositeur, la lecture de livres vrais, ainsi dit Quignard. On en viendrait presque à porter un démenti à Leibniz pour lequel toute perception n’apparaît que dans la diminution des imperceptions dont elle procède, ce qui ferait du silence, à le suivre littéralement, un bruit dégradé ou raréfié et conséquemment, des raffuts, tumultes et autres bruits, la référence normée.
Dans un petit livre — Éloge du génie*** — consacré triptyquement à un écrivain (Thomas Bernhard), un pianiste (Glenn Gould), un peintre, Vilhelm HammershØi, l’auteur réserve à ce dernier un éloge du silence dont il fait aussi une énigme. Certes, le silence « peint » – une fois passée la surprise de cette antinomie puissante – ce n’est pas une chimère, ce n’est pas un sentiment. Les pays nordiques appellent vie silencieuse ce que nous appelons « nature morte » : l’expression désigne, par exemple, les tableaux d’Evaristo Baschenis**** où les instruments de musique sont retournés de sorte qu’on ne peut les jouer, qu’aucun son ne peut en venir, qu’ils sont silencieux, pas muets, d’eux toute musique est possible. Le silence, en peinture, c’est (aussi) une pause, une suspension, une absence de lumière, qui font tant d’autres noms nous revenir auxquels nous n’aurions pas d’abord pensé. Pour moi, les Raboteurs de parquet de Caillebotte qui triment en silence bien qu’ils ne soient évidemment pas dans le silence.
* texte pourtant déjà écrit, autrement … le signe que la question m’obsède ? Archives – 15 Août 2022 : les objets de l’été – 7 – ; **à propos d'un film d’Antonioni sur la Chine ; *** Patrick Rogiers, Arléa – oct. 2019 ; ****(1617-1677 qui fit l’objet d’une exposition à la galerie Canesso à Paris du 06/10 au 10/12 2022). Il y eut aussi au Musée Rath de Genève une exposition L’art est-il silencieux ? en 2019.
/image%2F2226645%2F20161227%2Fob_9506b1_brancusi.jpg)
